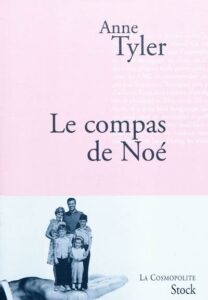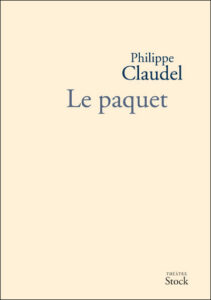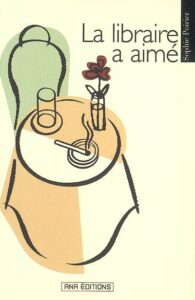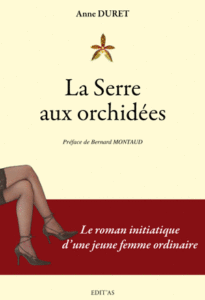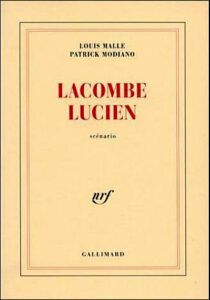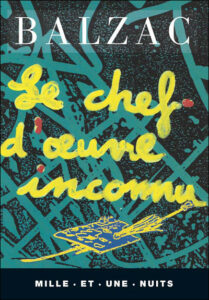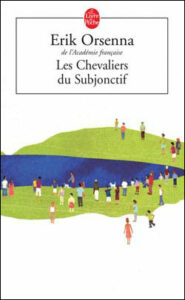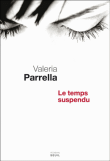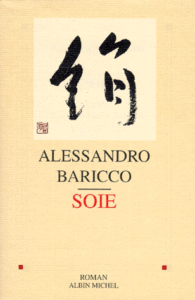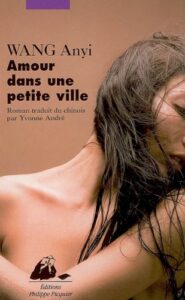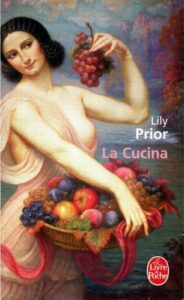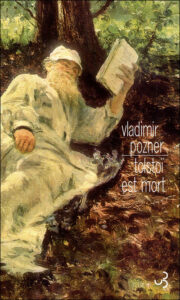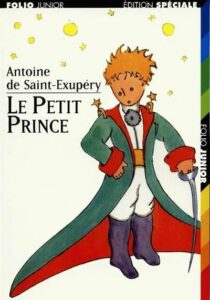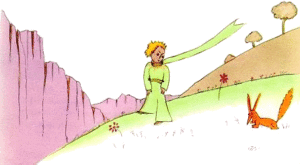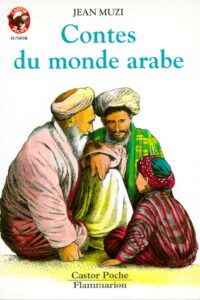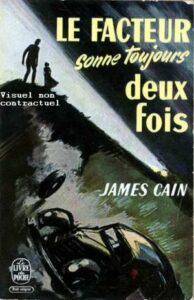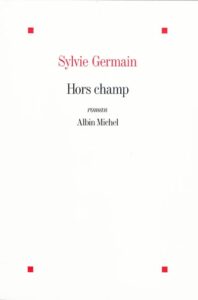Roman de Thibaut de Saint Pol.
En juin 1940, la Wehrmacht est aux portes de Paris. Au Quai d’Orsay, comme dans tous les ministères français, c’est l’affolement. C’est dans l’odeur de papiers brûlés et dans le vacarme d’une fuite désordonnée que Madeleine, jeune employée de bureau, se voir confier un des symboles de l’honneur de la France, le traité de Versailles. L’inestimable parchemin fait la preuve de la culpabilité de l’Allemagne lors de la précédente guerre. À ce titre, le Führer veut s’en emparer pour le détruire. De Paris à Toulon, en passant par Lyon et Montpellier, Madeleine tente de mettre la relique en lieu sûr, suivie de près par Heinrich, un officier allemand déterminé à détruire lui-même le Diktat, cette preuve infamante de l’humiliation subie par son pays en 1919. En 2009, Théobald, le petit-fils d’Heinrich, frappe à la porte d’une vieille femme recluse dans une petite commune du Var.
Une lecture bien décevante voire agaçante. J’ai trouvé l’écriture détestable, au croisement du pire de tous les romans de gare, des romans d’aventure à deux sous et des romans historiques de bas étage. Le prétexte historique n’est pas mauvais, bien au contraire. « Sans le Diktat, on ne comprend pas grand-chose au XX° siècle. » (p. 72) Courir sur les traces du traité de Versailles a son charme, même si certaines pages m’ont désagréablement rappelé le mauvais Da Vinci Code de Dan Brown. Hélas, tout n’est que caricature dans ce roman.
Les rancœurs présentes des deux côtés du Rhin sont incarnées dans des personnages trop peu travaillés et improbables. Certes il y a eu des héros pendant la guerre, mais Madeleine n’est pas crédible. La petite employée administrative sans envergure devient une pasionaria en quelques jours. « Nos soldats étaient les plus forts, et notre cause plus juste. » (p. 11) Sa réaction face au régime de Vichy est inappropriée : la majorité des Français a accueilli Pétain en sauveur et sa demande d’armistice comme la seule façon d’éviter la boucherie de 14-18. Les récriminations sont venues plus tard, après la première euphorie dissipée.
Heinrich est plus convaincant. L’officier de la Wehrmacht, dévoué au Reich, plein de morgue envers les vaincus, est un espion satisfaisant tant qu’il joue au chat et à la souris avec la petite française qui prend le temps de batifoler avec lui au lieu de s’en tenir à sa mission. Son mépris des SS est justifié bien que trop répété. Cependant, ses pensées nostalgiques sur la beauté de son pays et la chaleur de son foyer sont des clichés ridicules. Il fait du traité de Versailles le responsable de tous les maux de l’Allemagne, il impose le Diktat comme raison absolue d’entrer en guerre contre l’Europe entière qui a réduit son pays à la soumission. En cela, il pense comme les Allemands de cette époque. Et c’est là que le bât blesse ! Aucune nuance, aucune finesse dans la psychologie du personnage ! Et comme dans le pire des romans d’espionnage, les deux agents ennemis succombent à l’amour et renoncent pour partie à leur mission.
La construction du roman présente un certain intérêt. Le récit de Madeleine, le journal d’espion d’Heinrich et le récit de Théobald occupent successivement les chapitres du roman. Les informations importantes sont ainsi dévoilées par des narrateurs auxquels on ne s’attend pas. Le style emphatique de Madeleine est tout simplement insupportable: elle ne sait que réaffirmer son engagement patriotique en pointant du doigt les Français apeurés qui ont préféré se faire discrets. Elle brandit sa mission comme une preuve de vertu morale, entrecoupant son discours d’allusions agaçantes à sa piété religieuse et de diatribes mélodramatiques envers l’envahisseur. J’ai préféré la langue utilisée par Heinrich, le style télégraphique, très succinct, la forme de notes écrites rapidement au cœur de l’action, en prise avec la réalité. Mais là aussi, son emphase patriotique est imbuvable. Reste le discours de Théobald, son mépris affiché pour le peuple français qui réécrit l’histoire pour nier ses responsabilités ou endosser le beau rôle. La quête de réponses sur le passé de son aïeul revêt malheureusement les apparences d’un voyeurisme fouineur très déplaisant.
Alors… suis-je passée à côté de ce livre supposé faire vibrer ma fibre patriotique? Est-ce un roman ironique, à lire au second degré? Si c’est le cas, la quatrième de couverture est trompeuse. Est-ce un vrai roman historique sur fond d’espionnage? Dans ce cas, l’auteur aurait dû creuser davantage son sujet au lieu d’accumuler les clichés que tout le monde a déjà lus. Je trouve la première de couverture affreuse, mais les goûts et les couleurs… Étrange de trouver ce roman chez Plon qui m’a toujours paru être une maison de qualité.
Voilà probablement un texte à faire lire à des adolescents : il y a de l’aventure, suffisamment mais pas trop d’histoire pour donner l’impression de lire « un livre de grand », les personnages sont faciles à cerner (et on en fait bien vite le tour !).