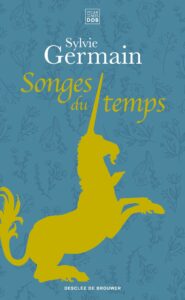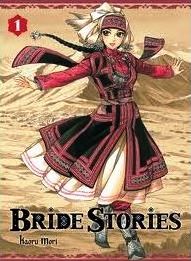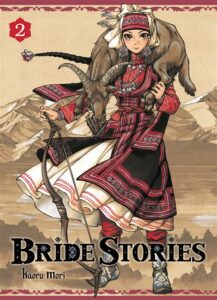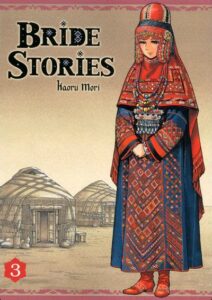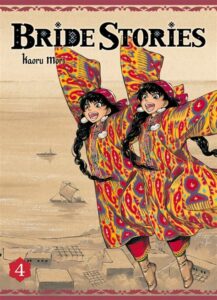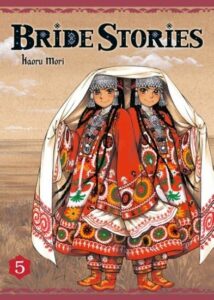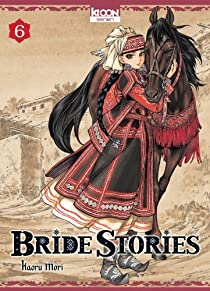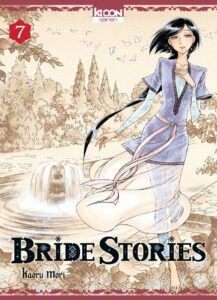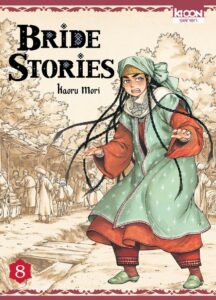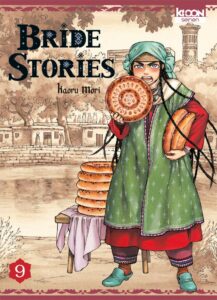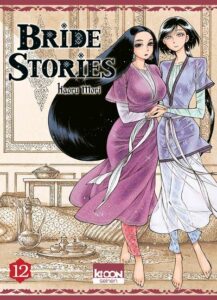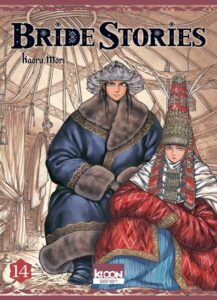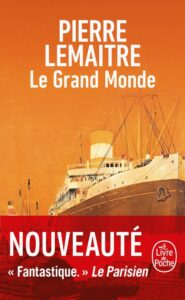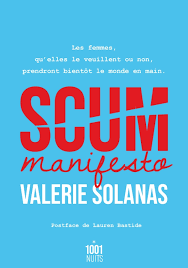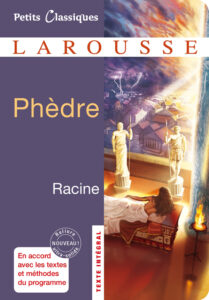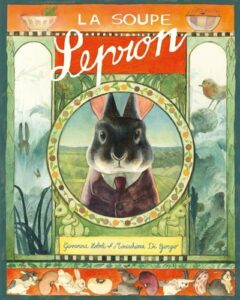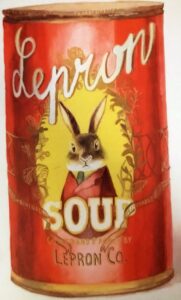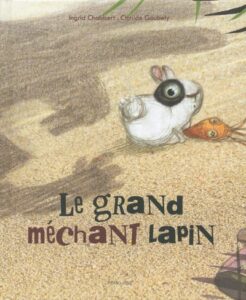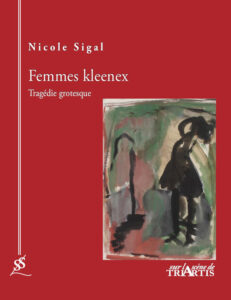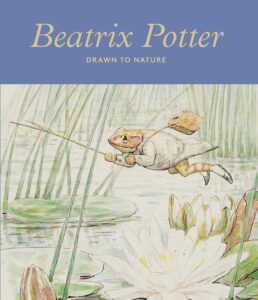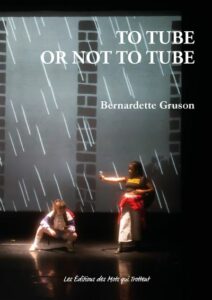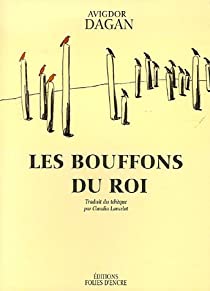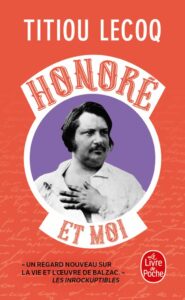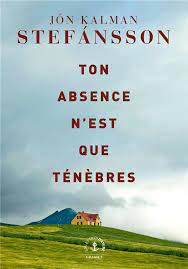Essai de Florence Porcel.
En 2021, Florence Porcel porte plainte contre le prédateur qui l’a violée deux fois. « En m’adressant à la justice, ma honte, mon incommensurable honte, deviendrait nationale. » (p. 12) Elle qui ne demande que réparation perd tout : sa carrière, ses revenus, sa vie privée. Dans ce texte, elle dénonce cette honte que la société inculque aux filles, dès le plus jeune âge, d’appartenir à ce sexe dit faible. « Ce qui n’est pas normal, c’est la honte que l’on ressent à cause de celle qui est projetée sur nous, par des individus, des idées reçues, des cultures ou des sociétés. » (p. 34) L’autrice explore les notions de dignité, d’honneur et déshonneur, d’humiliation et de culpabilité pour comprendre pourquoi, elle, victime de violences sexuelles, est celle qui a le rouge aux joues, au ventre et à l’âme. « Ma honte était la conséquence d’actions criminelles, commises par autrui. » (p. 20)
Les extraits de sa déposition et du rapport psychiatrique demandé par la justice sont glaçants de déshumanité, nourris de culture du viol et de slut-shaming. « La présomption de malhonnêteté envers les femmes est un principe qui ne faiblit pas, voire qui s’aggrave. » (p. 71) Florence Porcel n’en revient pas de l’inégalité de traitement entre elle et celui qu’elle a dénoncé, et qui a déposé plainte pour diffamation. « Je n’ai aucun problème à ce que le prédateur soit présumé innocent. Ce qui me pose problème, c’est que l’enquête ait été faite à ce point à charge contre moi. » (p. 118) Toujours, dans les affaires de viol, cette amère rengaine qui fait de la victime la coupable. L’autrice rappelle, avec clarté et arguments, qu’il n’existe pas de bonnes victimes : il n’existe que de vraies victimes, très souvent frappées de sidération – mécanisme de défense/survie indispensable et inconscient – et à qui il ne faut pas reprocher de dénoncer ou de ne pas parler (Paye ton injonction contradictoire !). « La honte pèse lourd dans la non-dénonciation des crimes sexuels. » (p. 183)
Dans son roman, Pandorini, Florence Porcel a déjà raconté son histoire. Avec cet essai, elle tente une nouvelle fois de surmonter la honte et appelle de ses vœux qu’on laisse les victimes tranquilles, qu’on ne les enjoigne plus à se justifier et à se comporter selon des stéréotypes cinématographiques très éloignés de la réalité du viol. « Mon dossier a été classé sans suite en partie parce que deux personnes semblent persuadées qu’une victime de viol pleure forcément quand elle raconte. » (p. 109) Comme l’autrice le dit plusieurs fois, le véritable viol est silencieux, il ne fait pas de bruit. Une façon de se réhabiliter, de se libérer du poids injuste d’une faute qu’elle n’a pas commise, c’est l’écriture : utiliser des mots pour briser le silence, pour faire du bruit. « Ma honte s’est muée en porte-voix. Ce livre en est la preuve. » (p. 161) Les dernières pages sont bouleversantes : l’autrice salue ses compagnes d’infortune, ces autres victimes du même prédateur. Elle dit sa joie d’avoir trouvé des sœurs au cœur du malheur.
Chaque mot de son récit sonne juste et résonne dans le crâne comme un uppercut. Elle raconte la machine lente et douloureuse qu’est l’instruction judiciaire, les traumatismes qui subsistent des années après les viols. La dernière phrase, surtout, nous rappelle que le violeur n’est pas un monstre sauvage, dans un parking, un couteau à la main. Le plus souvent, il est Monsieur Tout-le-Monde. Parfois, il a même micro ouvert en prime time. « Le violeur en série ne se cachait pas : il était tous les soirs dans votre salon. » (p. 207)
Je serai toujours du côté des victimes. J’écoute et je crois leur parole. Les violences que j’ai subies font que je sais, je sais que c’est vrai. On n’invente pas ces choses-là. On n’a rien à y gagner. Pour autant, on ne se taira et on ne se terrera plus : ce n’est plus à nous d’avoir honte.
Évidemment, Honte prend place aux côtés de Pandorini dans ma bibliothèque féministe.