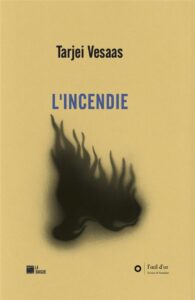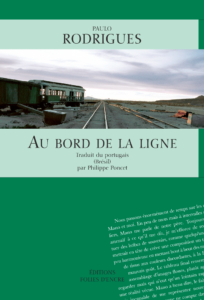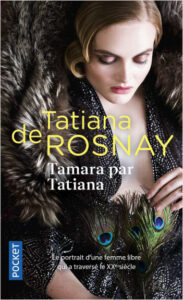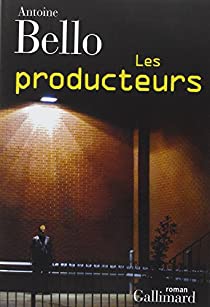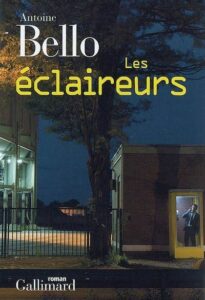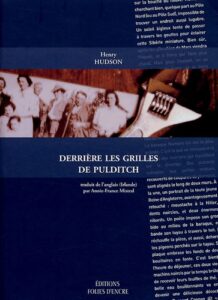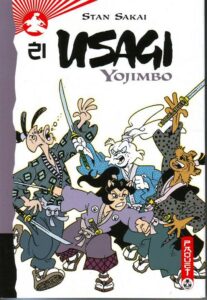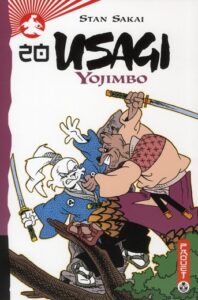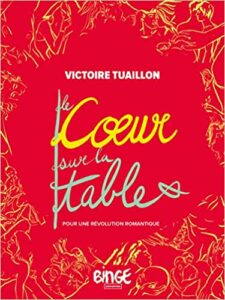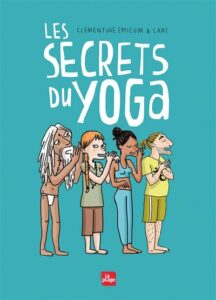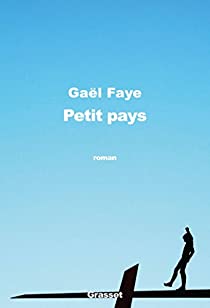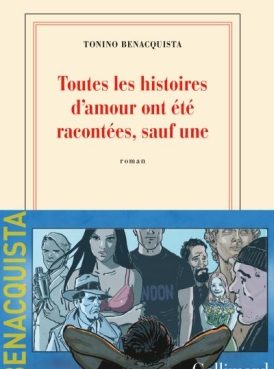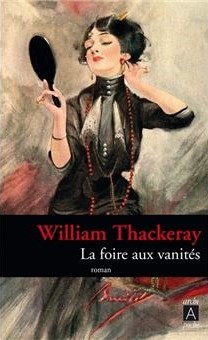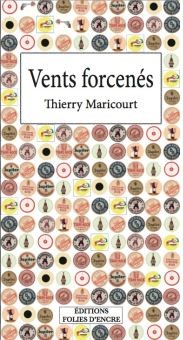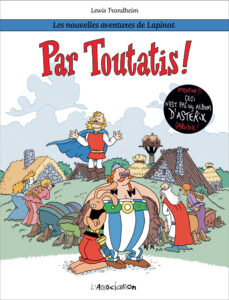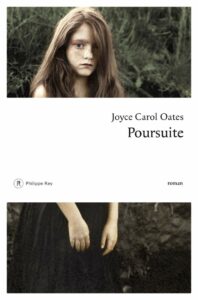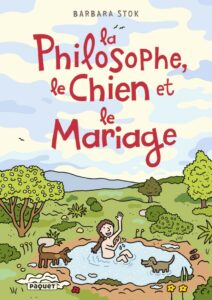Ouvrage de Victoire Tuaillon.
Avec cet ouvrage, l’autrice se fonde sur les discussions et les témoignages enregistrés lors de son podcast Le cœur sur la table. Son grand sujet, ici, ce sont les sentiments. « L’amour, c’est un grand sujet politique. » (p. 10) L’autrice explore la diversité des relations humaines et interroge la place qu’on laisse à l’amour dans notre époque saturée d’images pornos et toujours infusée d’une culture patriarcale oppressive. « Je ne vois pas comment l’amour peut circuler si nous restons enfermé·es dans des rôles de genre étriqués – les hommes d’un côté, les femmes de l’autre, les uns au-dessus, les autres en dessous. » (p. 10) Le bel amour – et c’est une évidence trop souvent négligée –, c’est celui qui se fonde sur et qui nourrit l’égalité, le partage et la liberté. Cela suppose évidemment de remettre en question, sans pour autant le détruire, le modèle que la société voudrait imposer. « Le couple, c’est la relation à laquelle on associe le sentiment amoureux dans notre société. » (p. 21) Rien n’interdit d’inventer autre chose : chacun·e peut trouver ce qui lui convient. Pourquoi pas un couple qui choisit de ne pas vivre sous le même toit, ou des amitiés aussi fortes que des histoires d’amour. Au-delà du sexe, ce qu’il faut trouver et donner pour être un humain complet, c’est la tendresse et le réconfort. Et cela est possible en dehors du couple traditionnel hétérosexuel. À titre strictement personnel, ce n’est pas la passion que je recherche en amour, c’est la complicité et la confiance.
Réinventer l’amour, c’est aussi questionner l’imaginaire amoureux qui prône la fusion avec sa moitié ou qui érotise les viols ou les prétendus crimes d’amour. Redisons-le clairement : personne ne tue ou ne blesse par amour, sinon ce n’est pas de l’amour. Pour comprendre ça, Tant pis pour l’amour de Sophie Lambda est parfait. De fait, il faut dénoncer le business immonde des coachs en séduction qui véhiculent un fantasme de l’homme tout puissant et de la femme en tant que proie. « Se comporter comme un homme, quand on écoute bien le discours de Winner, c’est avoir droit aux services sexuels des femmes, ces créatures trop coincées qu’il faut libérer de leurs blocages. » (p. 126) Valoriser l’amour plutôt que la conquête, c’est aussi rendre service aux hommes qui sont enfermés dans des schémas performatifs et enjoints d’ignorer leurs ressentis pour n’être que des collectionneurs de trophées. Non, la friend-zone n’est pas honteuse ni synonyme d’échec. Oui, l’amitié d’une femme vaut autant que les faveurs sexuelles qu’elle pourrait accepter de partager. « Il faut […] qu’on cesse de valoriser cette culture qui confond séduction et harcèlement ; il faut que les hommes changent. » (p. 130)
Comme l’a si clairement démontré Mona Chollet, l’hétérosexualité enferme l’amour dans des schémas à remettre en perspective. S’y conformer n’est pas un tort, mais il faut le faire en pleine conscience et en comprendre les tenants et aboutissants. « Si on envisage toutes les relations comme une lutte de pouvoir, alors il ne peut pas y avoir d’amour. Si on n’envisage les autres que comme des moyens alors on ne les aime pas vraiment. » (p. 150) C’est aussi le patriarcat qu’il faut démonter, pierre par pierre, pour que chacun·e retrouve l’estime de soi et se réapproprie son corps loin des diktats et des attentes formulés par des millénaires d’oppression masculine. À chacun·e de se replacer au centre de sa propre existence, en tant que sujet et non en tant qu’objet à normer. L’autrice rappelle que l’écoute et l’empathie sont des qualités humaines, et non uniquement féminines, tout comme il n’existe pas de valeurs strictement masculines. Plutôt que d’érotiser l’inégalité, il faut valoriser la différence et en faire le terreau d’un amour riche et ouvert à la multiplicité. Ce qui compte, finalement, c’est d’aimer et être aimé·e beaucoup et pour les bonnes raisons.
La mise en page de cet ouvrage est un vrai plaisir pour les yeux. Certains propos sont passés en gras, d’autres en rouge et d’autres encore sont en italique. Tout est fait pour qu’on ne rate rien de ce que l’autrice veut nous dire. Il y a des pleines pages en camaïeu de rouge qui reprennent des verbatims du podcast. Chaque fin de chapitre offre une petite bibliographie constituée de livres, séries, films, œuvres d’art et podcasts pour continuer d’explorer le sujet évoqué et ouvrir d’autres réflexions. C’est exactement le genre de livres qui me plaît : il ne ferme rien et il reconnaît que le champ d’étude est immense et nourri par toutes les formes d’art et de pensée. Les 30 pages finales de ressources sont passionnantes et pertinentes. L’ouvrage de Victoire Tuaillon a déjà trouvé sa place parmi mes autres lectures féministes.