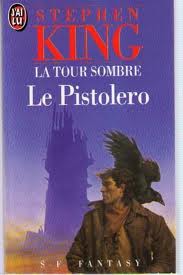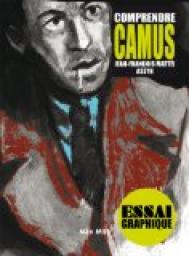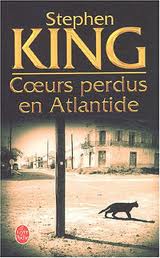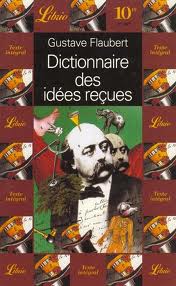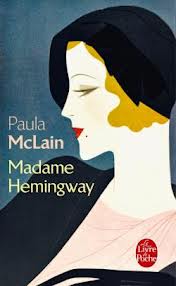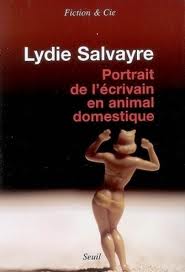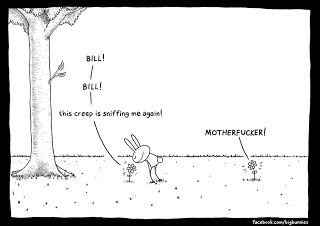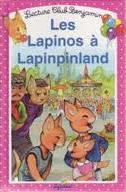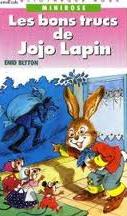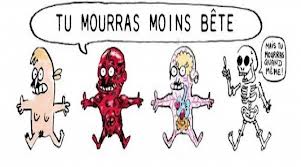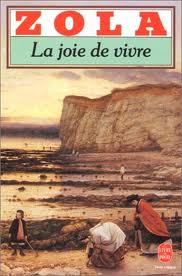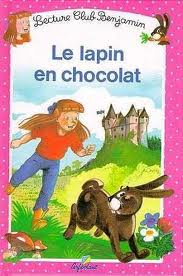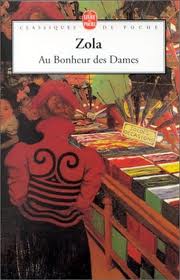Recueil de textes (2 romans et 3 nouvelles) de Stephen King.
1960. Bobby Garfield a 11 ans et sa plus grande préoccupation est d’acheter ce magnifique vélo qui a vu dans une vitrine en ville. Ses amis sont Sully-John et Carol Gerber. Il vit seul avec sa mère, une femme souvent froide, obsédée par l’argent et peu amène avec les hommes. « Il avait peur de sa mère, et pas qu’un peu ; les colères qu’elle piquait et les ressentiments qu’elle pouvait entretenir longtemps n’étaient qu’en partie responsables de cette peur, qui tenait avant tout au sentiment affreux de n’être que peu aimé et au besoin de protéger d’autant plus ce peu d’amour. » (p. 64) Quand Ted Brautigan s’installe dans l’appartement du dessus, Bobby ne sait pas encore qu’il vit son dernier été de petit garçon. Le vieux Ted est obsédé par ceux qui appellent des crapules de bas étage, des hommes vêtus de longs manteaux jaunes qui en ont après lui. Il charge Bobby se garder l’œil ouvert et de lui rapporter toutes sortes d’évènements. Le gamin croit d’abord que Ted est fou, mais peu à peu, le monde semble devenir moins sûr.
1966, université du Maine. Pete Riley est un jeune étudiant boursier qui sait qu’il doit obtenir de bons résultats pour ne pas être recalé et ne pas être appelé par la conscription. La guerre du Vietnam vient de commencer et les consciences commencent à s’échauffer et à protester. Mais ce n’est pas le cas de tout le monde à l’université. « Lorsque les gens parlent de l’activiste des années soixante, je dois faire un effort pour me rappeler que la majorité de ces mômes avaient traversé cette période de la même façon que Nate. Ils restaient plongés dans leur livre d’histoire, sans lever le nez pendant que l’histoire se produisait autour d’eux. » (p. 364) Ce n’est pas les livres d’histoire qui accaparent toute l’attention de Pete, c’est un jeu de cartes. Dans la salle commune de son dortoir, les résidents s’affrontent dans des parties enragées de chasse-cœur. Pete sait qu’il risque sa bourse à passer ses nuits au milieu des cartes, mais rien ne semble pouvoir le détourner de cette fièvre du jeu, pas même Carol Gerber.
1983. Willie Shearman est un vétéran, héros du Vietnam, qui s’est fait un métier de mendier sur la Cinquième Avenue en prétendant être aveugle. À quelques jours de Noël, on suit toute une journée de cet imposteur qui ne cesse de faire pénitence pour la raclée qui a donné à Carol Gerber quand il était gamin. En outre, il ne peut oublier la guerre et ses horreurs. « Dans la brousse, il fallait parfois quelque chose de mal pour empêcher autre chose de plus mal encore. » (p. 548) Le pire justifie-t-il le mauvais ? C’est ce que Willie ne peut s’empêcher de se demander en serrant un gant de baseball qui n’est pas le sien.
1999. John Sullivan quitte son travail et rentre chez lui. Deux femmes ont marqué sa vie. Il y a Carol Gerber qui fut sa première petite amie. Et il y a cette mama-san qui le suit depuis qu’il a quitté le Vietnam. Certes, il a réussi sa vie, mais les démons de la guerre sont accrochés à son dos, comme à celui de tous les vétérans. « Ceux qui n’ont pas eu de cancer sont alcooliques à mort, et ceux qui ont réussi à laisser tomber la gnôle marchent au Prozac. » (p. 608) Pas de gloire pour les soldats qui ont ravagé le Vietnam, juste des souvenirs aussi collants et brûlants que le napalm.
1999. Bobby Garfield est de retour à Harwich, la banlieue de son enfance. « Quarante ans, c’est long. Les gens grandissent… ils grandissent et laissent derrière eux l’enfant qu’ils ont été. » (p. 668) Mais Bobby en est certain, il va retrouver Carol Gerber. Et peut-être aussi Ted Brautigan : le vieux lui avait fait une promesse et tout indique qu’il va la tenir. Finalement, tous les indices se recoupent : le gant de baseball, le roman Sa majesté des mouches de William Golding et Carol Gerber.
Les histoires de Bobby, Pete, Willie et John Sullivan sont comme des nouvelles indépendantes, ne serait Carol Gerber qui, tel le lapin blanc, passe de l’une à l’autre et relie les intrigues et les garçons entre eux. Au cours de la première histoire, l’angoisse monte progressivement, mais le mystère reste entier. Dans les trois autres histoires, point de surnaturel, si ce ne sont quelques flocons qui pourraient très bien passer inaperçus. Quand tout se rejoint, se noue et forme enfin le tableau ultime, on ne peut que saluer le talent de l’auteur qui fonde toute son histoire sur un amour d’enfance et sur une promesse. Moi qui n’aime que très peu les romans d’horreur, j’étais d’abord inquiète en ouvrant ce livre. Mais Stephen King a produit un récit très particulier qui relève du conte initiatique, du pamphlet pacifiste et du roman à clés.
L’Atlantide, c’est l’Amérique des sixties, un continent mythique disparu sous les bombes de la guerre du Vietnam. Oui, les bombes lâchées ailleurs ont tout de même détruit le pays qui les a envoyées. Les cœurs perdus, ce sont d’abord ceux du jeu de cartes qui a rendu presque fous tous les étudiants d’un dortoir universitaire. Ce sont surtout les espoirs et les rêves qui se sont échoués, soit sur la guerre, soit sur la vie. « Les cœurs peuvent se briser. Oui. Les cœurs peuvent se briser. Parfois, je me dis qu’il vaudrait mieux que nous mourrions en de tels moments, mais nous ne mourrons pas. » (p. 524 & 525) C’est donc le cœur en miettes, plus ou moins rafistolé, que les êtres continuent de vivre. Carol n’est pas le personnage principal, mais elle motive toute l’intrigue à mesure que son histoire se dessine dans le récit de l’un ou les souvenirs de l’autre. Le cœur le plus perdu, c’est le sien, celui de la gamine amoureuse de Bobby, celui de l’activiste presque par hasard et celui de l’enfant maltraitée par une bande de jeunes brutes. Carol est peut-être la meilleure incarnation des sixties. Elle est les sixties, génération désabusée.
Oubliez vos préjugés sur Stephen King : ici, le maître de l’horreur est subtil et génial. Et grâce à lui, j’ai découvert un artiste, Phil Ochs. Il ne me reste qu’à voir le film de Scott Hicks avec Anthony Hopkins dans le rôle de Ted Brautigan.