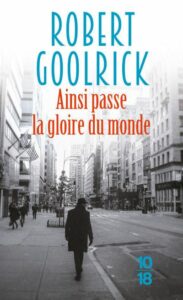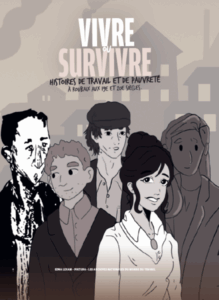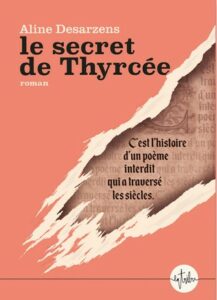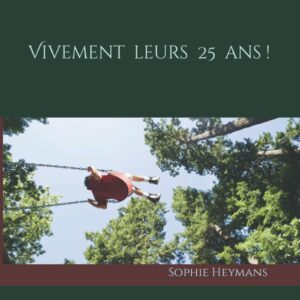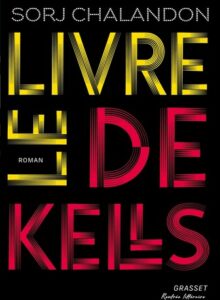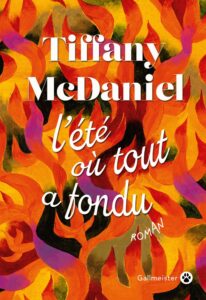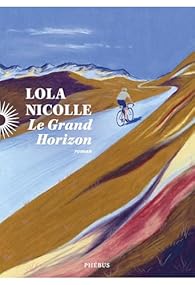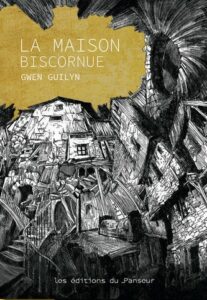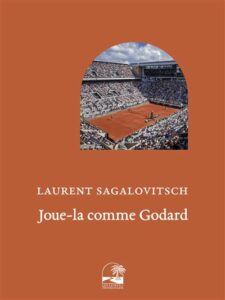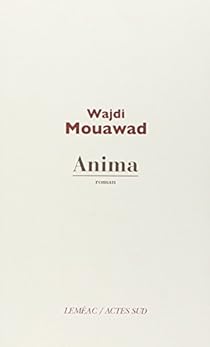Roman en six tomes de Michael McDowell.
Je résume l’intégralité de l’histoire : si vous craignez les dévoilements, passez votre chemin !
1 – La crue
Pâques 1919, la petite ville de Perdido, en Alabama, est ravagée par la montée des eaux des rivières Blackwater et Perdido. Pour Mary-Love, matriarche du clan Caskey, ce n’est pas la pire des catastrophes. Surgie de cette crue ravageuse, Elinor Dammert est aussi rousse qu’elle est étrangère. Et voilà qu’elle s’intéresse à Oscar, héritier des Caskey. Mary-Love ne laisse rien passer à cette inconnue : pour accepter que son fils quitte la maison, elle demande un sacrifice considérable.
Le premier tome de la saga pose le cadre haletant d’une histoire qui enchaîne les rebondissements. Le feuilleton ne fait que commencer et une chose est certaine, ce sont les femmes qui mènent le jeu ! « Les femmes découvrent les choses en premier, puis elles en parlent aux hommes – autrement, les hommes ne découvriraient jamais rien. » (p. 132) J’ai immédiatement été conquise par les éléments fantastiques du récit et le pouvoir des eaux troubles à la confluence des deux rivières.
2 – La digue
Bien qu’Elinor Caskey assure que Perdido n’a plus à craindre les flots tumultueux des rivières qui l’entourent, la ville engage des travaux colossaux pour se protéger. « Cette digue – si jamais un jour elle est construite – n’apportera rien de bon à la ville. […] Moi vivante, et tant que j’habiterai dans cette maison, il n’y aura pas de crue à Perdido, avec ou sans digue. Par contre, quand je serai morte, […] avec ou sans digue, cette ville et tous ses habitants disparaîtront de la surface de la terre. » (p. 26) Voilà qui sonne comme une sombre prophétie, mais personne n’en tient compte. Mary-Love reste une matriarche tyrannique : si son fils a échappé à son emprise, il lui reste Sister et Miriam, sa fille et sa petite-fille.
L’auteur maîtrise le rythme de son histoire et ménage le suspense avec des prétéritions habiles. J’ai dévoré le deuxième tome en quelques heures et immédiatement commencé le suivant. Le format feuilleton, ça marche toujours magnifiquement sur moi !
3 – La maison
Le temps passe et voilà déjà 1928. Elinor et Oscar vivent heureux avec Frances, leur deuxième fille, dans la grande maison offerte par Mary-Love. Cette demeure est sans conteste la plus belle de Perdido, mais les choses précieuses ont toujours un prix. La penderie de la chambre d’amis terrifie Frances, enfant maladive et tendre qui est très différente de Miriam, son aînée. « La rivalité entre les deux sœurs était représentative de l’incroyable animosité que nourrissaient l’une envers l’autre Elinor et Mary-Love. » (p. 18) Ailleurs en ville, Queenie, membre éloigné de la famille, souffre des violences de son époux, mais elle peut compter sur le soutien des Caskey. « En dépit des animosités individuelles, les Caskey formaient désormais un clan plus jeune, plus robuste et plus heureux que jamais. » (p. 38)
L’arbre généalogique et la carte de Perdido, insérés en début de tome, évoluent avec le récit : le premier s’étoffe, la deuxième se transforme. Dans cette famille, les rancœurs sont longues et amères, mais c’est avec un front uni que les membres progressent dans le monde. Quant à ma lecture, elle progresse à toute allure !
4 – La guerre
Après les mornes années qui ont suivi la crise de 1929, les affaires du clan Caskey tournent à plein régime : les scieries embauchent sans cesse, la propriété ne cesse de s’étendre et la guerre emplit encore les caisses grâce aux commandes passées par l’armée. La nouvelle génération de Caskey entre dans l’entreprise familiale et gagne en autonomie. « C’est le problème de cette famille… On ne peut jamais être sûr que les choses restent longtemps ce qu’elles sont. » (p. 41) Les jeunes – et les moins jeunes – se marient et ont des enfants, et des membres qui semblaient éternels disparaissent.
Quand la mort frappe chez les Caskey, elle n’est jamais douce. Qu’elle soit donnée ou subie, elle est toujours entourée d’un certain mystère : rien n’est jamais ce qu’il semble être dans cette famille puissante, et le plus sûr est sans aucun doute de garder le secret.
5 – La fortune
Tout le monde le sait à Perdido, la famille Caskey est richissime. « Le problème, […], c’est que vous ignorez combien d’argent vous avez. » (p. 15) Miriam a pris en main la scierie et, avec l’aide de Billy, le mari de Frances, elle n’aime rien tant qu’accroître la richesse de chacun membre de la famille. Désormais, c’est le pétrole qui est la source d’abondance. En retrait des affaires, mais toujours prompte à conseiller son époux ou ses proches, Elinor supervise en silence la réussite familiale. La nouvelle matriarche s’assure que chacun·e reçoit ce qui est juste. « Dans la famille Caskey, toute interrogation était toujours tuée dans l’œuf à la seule mention d’Elinor. » (p. 63)
J’ai particulièrement aimé ce tome où Frances découvre à quel point elle ressemble à sa mère et combien est lourd son mystère. Le fantastique est omniprésent dans le roman, porté par deux personnages et soutenu par de nombreuses manifestations inquiétantes. Je me régale comme avec un Stephen King, dont Michael McDowell a scénarisé plusieurs romans.
6 – Pluie
Les années 1960 approchent : l’âge rattrape certains personnages et l’on se demande ce qu’il va advenir des Caskey. « Cette famille n’a pas besoin d’intrus. » (p. 34) Et en effet, les époux ou épouses sont des proches ou des personnes prêtes à devenir des Caskey. Les domestiques, même, sont de la famille, tant ils accompagnent les Caskey depuis plusieurs générations et connaissent, parfois sans le savoir, les terribles secrets de cette tribu.
Élément terrible de cette saga, c’est la façon dont les petits sont une monnaie d’échange. « Les enfants Caskey, une fois cédés, n’étaient jamais rendus. » (p. 70) Certes, ils restent dans la famille, mais les généalogies sont un peu brisées, comme les liens. Maternité et paternité ont peu de sens quand c’est le clan qui élève les jeunes générations. La fin de cette série littéraire ne m’a pas déçue : j’aime qu’une prophétie se réalise et que les promesses, même noires, soient tenues.
*****
Michael McDowell revendiquait le fait d’être un auteur commercial et d’offrir à son lectorat des textes faciles à parcourir, riches d’aventures et de rebondissements. Il aurait fait un parfait feuilletoniste au 19e siècle. Je me suis régalée avec cette histoire qui m’a rappelé la vouivre et Mélusine. Les spectres ne sont jamais loin et prenez garde aux créatures qui nagent dans les eaux troubles.