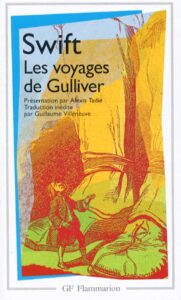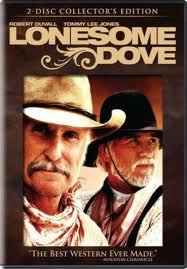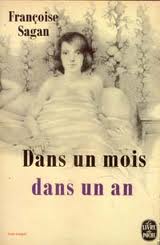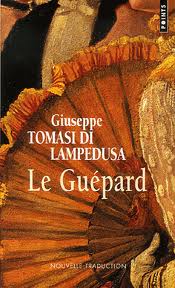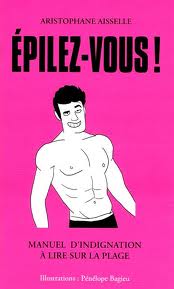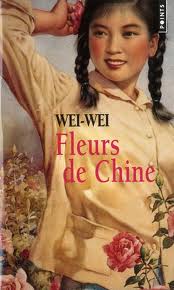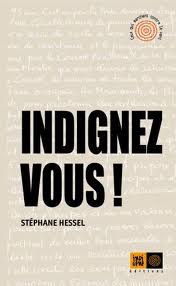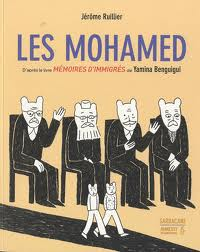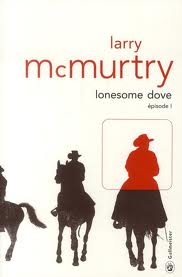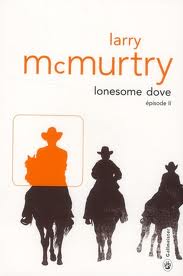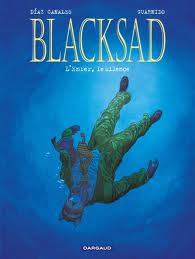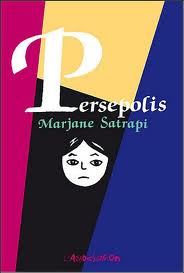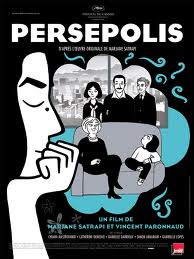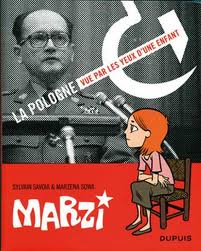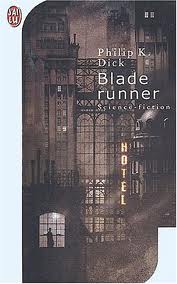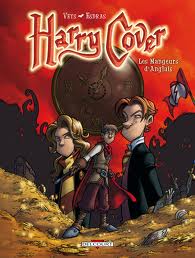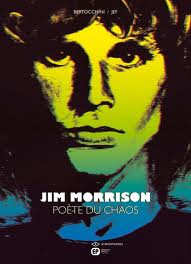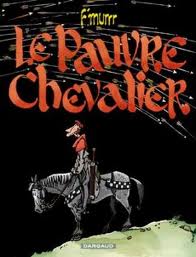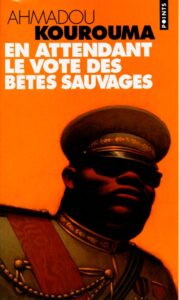
« Retenez le nom de Koyaga, le chasseur et président-dictateur de la République du Golfe. » (p. 9) Ainsi s’ouvre la première des six veillées en l’honneur de Koyaga. « Retenez mon nom de Bingo, je suis le griot musicien de la confrérie des chasseurs. » (p. 9) Avec son répondeur, Tiécoura, Bingo écrit la geste de Koyaga, président-dictateur africain. Pour cela, il remonte au père de l’homme, à Tchao : « Le tirailleur Tchao avait tué cinq Allemands pendant la Grande Guerre et avait été le premier homme nu à introduire l’habillement. En conséquence, le premier à introduire les débuts de la civilisation dans les montagnes. » (p. 25) Koyaga est un fils des Montagnes, un chasseur, un homme nu. L’ambition et la transgression du père touchent le fils. Koyaga sera décoré en Indochine. De retour au pays, il ne veut qu’être que le plus puissant. Sa mère, Nadjouma, est une sorcière nue, belle et envoûtante. Avec le marabout Bokano, elle soutient les ambitions de Koyaga. De coup d’état en assassinats, Koyaga devient le nouveau président de la République du Golfe.
Koyaga est accompagné de son âme damnée, Maclédio, un être qui a trouvé son « homme de destin » en la personne du chasseur des montagnes. « Maclédio est devenu votre pou à vous, Koyaga, perpétuellement collé à vous. Il reste votre caleçon œuvrant où vous êtes pour cacher vos parties honteuses. Cacher votre honte et votre déshonneur. Il ne vous a jamais plus quitté. Vous ne vous déplacerez jamais plus sans lui. » (p. 123) Tout bon tyran a son homme dévoué. Maclédio est plus qu’une ombre, c’est un prolongement organique du dictateur, une expression incarnée de la soumission au démon.
Koyaga sait tout, maîtrise tout. Mais que faire quand tout n’est pas assez ? « La création de son parti unique et sa nomination comme président-fondateur et président à vie n’apportent qu’un éphémère moment de joie à Koyaga. » (p. 292) C’est Maclédio qui trouve la solution et qui crée « des groupes de choc qui partout et toute la journée griotteront, louangeront Koyaga. » (p. 292) En effet, que vaut un souverain qu’on ne vénère pas ? Que vaut une idole à laquelle on ne sacrifie pas ?
Alors que Koyaga fête le trentième anniversaire de son arrivée au pouvoir, le pays est endetté et traverse une crise que renforcent l’insécurité et les soulèvements orchestrés par les « déscolarisés ». Le règne de Koyaga peut-il s’achever dans le sang et le meurtre ? D’aucuns lui font miroiter le contraire. « Vous briguerez un nouveau mandat avec la certitude de triompher, d’être réélu. Car vous le savez, vous êtes sûr que si d’aventure les hommes refusent de voter pour vous, les animaux sortiront de la brousse, se muniront de bulletins et vous plébisciteront. » (p. 381)
Le roman dénonce les régimes bananiers, mais il met en perspective les fautes et les ravages de la colonisation. « La transgression de Tchao ne déclencha pas la seule scolarisation des jeunes montagnards : elle entraîna le recrutement massif des montagnards comme tirailleurs. Elle fit des Montagnes un réservoir de tirailleurs dans lequel les Français puisèrent abondamment pour toutes les guerres. » (p. 27) L’Afrique sacrifiée, « terre aussi riche en violeurs de droits de l’homme qu’en hyènes » (p. 275) n’en finit pas de souffrir sur l’autel des guerres occidentales et internationales.
Néanmoins, Koyaga sait tirer profit des troubles mondiaux. Bien que son pays bafoue les droits de l’homme, il est une barrière au grand mal du vingtième, le communisme. Dans le pays de Koyaga se cristallisent les conflits du monde : « En moins de trois ans, trois tentatives perpétrées par le communisme international visant à la suppression physique de Koyaga ont été ourdies. Une persévérance ! Un réel acharnement qu’une seule et bonne signification pouvait signifier. Koyaga constitue un verrou important qui arrête le déferlement du communisme international sur l’Afrique. Koyaga est une pièce maîtresse de la lutte contre le communisme liberticide. L’Occident doit le savoir, le reconnaître, aider et secourir, soutenir beaucoup plus, beaucoup mieux son rempart, son bouclier. » (p. 287) La dictature de Koyaga est pleinement justifiée et encouragée par l’Occident capitaliste qui frémit devant le géant Rouge. Vaut-il mieux un dictateur sanguinaire, corrompu et avide de richesses ou un ennemi aux idéaux trop convaincants ? L’Histoire a fait son choix.
Les six veillées déroulent un conte traditionnel. C’est une véritable légende qui se raconte, entre magie et réalité : Koyaga est l’homme qui a vaincu une panthère, un buffle, un éléphant et un caïman. Il est homme que les bêtes sauvages redoutent et respectent. Des proverbes en introduction de chaque veillée annoncent les sujets classiques, les grands thèmes de réflexion que chaque homme doit aborder : la mort, la prédestination, l’apprentissage, la trahison, etc. L’existence de Koyaga est une tragédie africaine, un drame dans le désert. Mais c’est aussi un pamphlet au souffle brûlant, une critique acérée des régimes dictatoriaux africains. Toute louange est ici à double tranchant, vicieuse et serpentine puisque tout succès est issu du mal, de la haine et de la violence. Étourdi par les éloges et ivre de pouvoir, Koyaga n’entend pas le sifflement acerbe que modulent Bingo et Tiécoura. La célébration se fait portrait au vitriol et chaque touche du pinceau complète un hideux tableau.
Le roman d’Ahmadou Kourouma est exigeant et demande une concentration courageuse. Les récits qui s’égarent dans l’espace et le temps, les références historiques et le mélange des genres rendent le texte complexe. Mais également puissant et intemporel. Certes l’Afrique est ici mise au pilori, mais tous les continents ont leurs molochs. Peu importe que la République du Golfe n’existe pas : de vrais territoires souffrent de la même manière et l’exemple n’est pas assez puissant pour les pleurer tous.
Ahmadou Kourouma sait parler du continent africain. Dans une langue riche, parfois idiomatique, lourde de références, il célèbre une terre qu’on a violée, dépossédée de ses beautés sauvages et privée de ses traditions sainement barbares. Pantin entre les mains des autres, qu’ils soient Occidentaux ou Africains dévoyés, le continent n’en finit pas souffrir et de vomir des immondices par toutes ses plaies. En voilà une terre qui peut dire « Pourquoi m’as-tu abandonné ? » En attendant le vote des bêtes sauvages n’est pas un texte à refermer après lecture : c’est une réflexion qui ouvre, au-delà des mots, des infinis de questionnements humains.
Du même auteur, j’ai lu Allah n’est pas obligé.