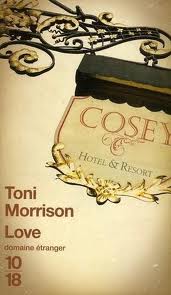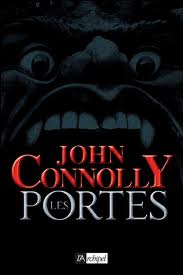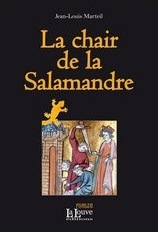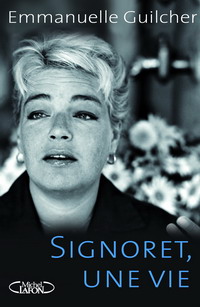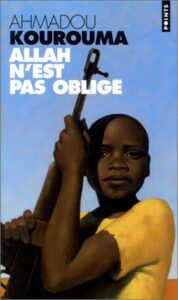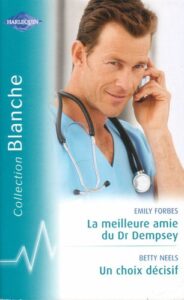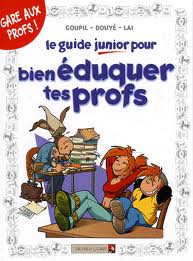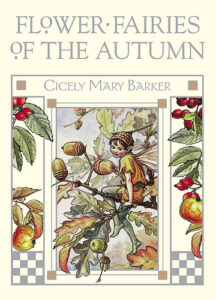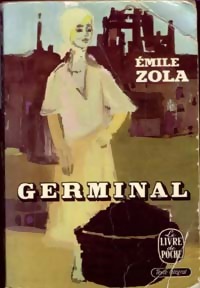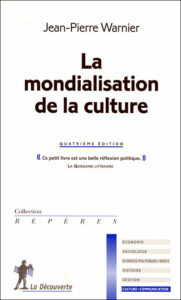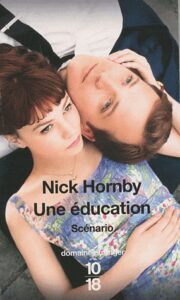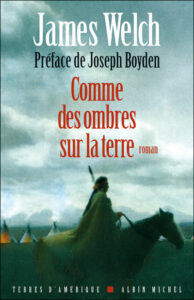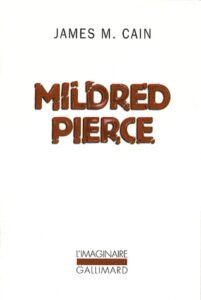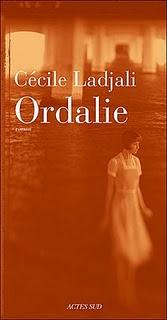Roman de James M. Cain.
1931, Glendale en Californie. Lassée de l’oisiveté de son époux Herbert, et des dettes qui s’accumulent, Mildred Pierce renvoie son mari de la maison et entreprend de gérer seule le foyer et l’éducation de ses filles, Véda et Ray. Après des mois difficiles, elle surmonte son horreur de l’uniforme et se fait embaucher comme serveuse dans un petit restaurant. Très fine cuisinière et experte en pies, les traditionnelles tourtes aux fruits américaines, elle commence un petit commerce de pâtisserie qui, dans un premier temps, lui permet enfin de payer ses dettes. Puis cédant aux exigences de grandeur de sa fille Véda et à ses propres ambitions, elle ouvre son restaurant et plusieurs succursales. « Ce n’était pas à elle qu’on pouvait raconter qu’on n’arrivait pas à s’en sortir, même avec cette Crise, quand on avait un peu de cran. » (p. 209) Portée par l’envie farouche de réussir par elle-même, Mildred se donne toutes les chances d’atteindre son objectif. Mais sa rencontre avec Monty Beragon, un dandy oisif et désargenté qui s’installe à ses crochets, et les difficultés qu’elle rencontre avec sa fille Véda, une orgueilleuse avide de luxe et de reconnaissance sociale, entraînent Mildred dans les méandres de la jalousie et dans les affres des affaires financières.
Le premier roman de l’auteur, Le facteur sonne toujours deux fois, m’avait enchantée et les similitudes avec Thérèse Raquin m’avaient ravie. Dans Milderd Pierce, ce sont les échos de L’assommoir qui m’ont fait trembler. Le roman noir tel que l’écrit James M. Cain use à merveille des ressorts du naturalisme et fait sien les codes du roman de mœurs. L’auteur brosse un remarquable portrait de femme. Volontaire et entreprenante, Mildred Pierce incarne le rêve américain du self-made man. À elle seule, elle monte une affaire rentable et bien tenue. Mais comme Gervaise, elle se laisse grignoter par les abus profiteurs d’un homme oisif et par l’attitude insolente et mauvaise d’une fille mal-aimante.
Véda a certains des traits de Nana. Avide de luxe, elle aspire à une existence au-dessus de sa condition, dans une société plus clinquante et distinguée. Les efforts prolétaires de sa mère ne lui inspirent que mépris et dégoût. Il n’y a que l’argent et les portes qu’il ouvre qui comptent à ses yeux. Coquette et aguicheuse, elle entend se servir des hommes pour satisfaire ses caprices. Outre cette nature profondément vénale, Véda est un monstre de cruauté envers sa mère. « [Mildred] ne pouvait briser Véda, quelque battue qu’elle fût. […] Elle avait peur de Véda, de son snobisme, de son mépris, de son orgueil invincible. Et elle avait peur d’autre chose qui semblait toujours être aux aguets sous l’élocution caressante, affectée de Véda: un désir froid, cruel, grossier de torturer sa mère, de l’humilier, et par-dessus tout de la blesser. » (p. 119)
En toutes choses entreprises, en toutes marques d’affection prodiguées, Mildred court après l’approbation de sa fille, après sa tendresse. Son amour fou pour Véda l’entraîne à tout lui pardonner, même les pires infamies, la poussant même à s’accuser des torts qu’elle ne peut reconnaître à son enfant. Cette malsaine passion maternelle possède tous les atouts d’un drame et il s’en faut d’un cheveu que celui survienne. Bien loin des canons classiques de la Mater Dolorosa, Mildred incarne une mère tragique qui, si elle pleure peu son enfant morte, se désespère de ne pouvoir garder l’affection de celle qui lui reste.
Convaincue des aptitudes artistiques de son enfant chérie, Mildred lui offre les cours de piano et l’instrument dont elle rêve tant. Le piano à queue, signe extérieur de richesse, est tout à fait vulgaire dans l’intérieur modeste des Pierce. Mais c’est ce piano qui cristallise tous les espoirs et toutes les déceptions de Véda. Quand il s’avère que l’enfant est une médiocre musicienne, c’est tout de même le piano qui la sauvera, en révélant son extraordinaire voix de soprano coloratura. Véda chante à merveille, mais ce n’est que chant fourbe de sirène, auquel sa mère se laisse prendre, encore.
L’amour entre Mildred et Monty Beragon revêt rapidement et vilainement les atours de la vénalité. Si Monty accepte avec condescendance chaque dollar que Mildred lui octroie et s’il se plie aux exigences qu’elle lui impose, il ne cède pas un pouce sur le champ de l’orgueil. Sa superbe se satisfait qu’une femme se soucie à sa place des désagréables et viles questions financières. Mildred, de son côté, ne peut pas quitter Monty grâce auquel elle a le sentiment que sa fille lui est revenue. Dépendante du train de vie auquel l’homme a habitué l’enfant, la mère ne peut jeter hors du foyer ce profiteur malséant et fat. C’est toujours auprès de Monty qu’elle croit trouver la solution pour gagner le cœur de Véda, oubliant, hélas, qu’un loup introduit dans un poulailler ne peut que faire des dégâts dans l’esprit d’une jeune dinde.
Les jambes de Mildred font tourner bien des têtes, ses pies font l’admiration gourmande de beaucoup, mais le drame de cette femme, dans les deux passions qui ponctuent sa vie, est de croire que l’argent lui permet d’acheter les sentiments de ceux qu’elle entretient matériellement. Mère passionnée et amante dévouée, elle serait prête à tout donner pour qu’on l’aime. Mais plus elle donne et plus Véda et Monty méprisent sa prodigalité sentimentale et financière. C’est à ses dépens, enfin, que Mildred apprendra que l’amour est la seule chose qu’on ne peut pas provoquer ni contrôler.
L’entourage de Mildred est réduit. Son interlocutrice privilégiée est sa voisine, Mrs. Guessler, une femme dotée du savant talent de pointer le bout de son nez quand on a besoin, ou non, de sa présence. Ses conseils matrimoniaux, parentaux, amoureux ou financiers découlent tous d’un bon gros sens et d’une volonté quasi pathologique de porter secours à son prochain. Mais sous des dehors respectables de matrone américaine, Mrs. Guessler dissimule un fond de rouerie tout à fait hilarant: la bonne femme joue les bootleggers de quartier et arrose sa voisine des liqueurs les plus inavouables de l’histoire de la Prohibition.
Ce roman est mon livre 2010, celui que je n’oublierai pas ! L’édition que j’ai acquise contient un DVD du film réalisé par Michael Curtiz, Le Roman de Mildred Pierce. Joan Crawford campe une Mildred Pierce énergique et séduisante, tout à fait à l’image du personnage écrit par James M. Cain. Le film propose une version différente du roman en introduisant un crime qui inaugure l’action. On assiste à l’assassinat de Monty qui s’écroule en prononçant un nom, celui de Mildred, tandis qu’une silhouette s’échappe de la maison. Cette modification ne nuit en rien au propos et renforce le côté « roman noir » du texte original. Le film s’attache à ménager une attente impatiente autour de l’identité du tueur. L’intrigue se déroule au cours de différents flash-back durant lesquels on assiste à l’histoire de Mildred Pierce telle que James M. Cain l’a écrite. Le roman est simplifié, certains personnages secondaires ont disparu, mais l’essentiel est là : Mildred est une femme d’affaires aguerrie, Véda est une enfant odieuse et cupide, Monty est un poseur nécessiteux, etc. Ce film est une merveille du cinéma des années 1940. L’image en noir et blanc a ce charme dont je ne me lasse pas. L’interprétation est excellente et la réalisation digne des meilleurs films noirs du cinéma américain.
Pour conclure, le livre de James M. Cain et le film de Michael Curtiz vont rejoindre en bonne place mes étagères intouchables, celles du haut desquelles on ne redescend que pour être relu et revu jusqu’à plus soif !