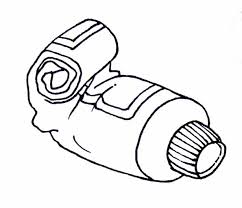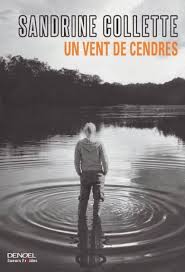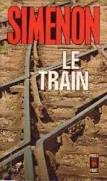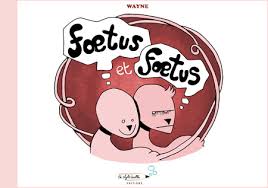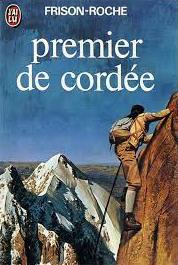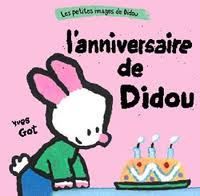Roman de Michel Tournier.
Abel Tiffauges est un garagiste persuadé d’avoir un destin grandiose à accomplir. « Ma vie fourmille de coïncidences inexplicables dont j’ai pris mon parti comme d’autant de petits rappels à l’ordre. Ce n’est rien, c’est le destin qui veille et qui entend que je n’oublie pas sa présence invisible mais inéluctable. »(p. 88) Doté d’une force physique hors du commun, Abel Tiffauges est fasciné par les jeunes garçons. Il les photographie, enregistre leurs voix et observe leurs jeux innocents. Son obsession pourrait lui valoir la prison, mais il y échappe quand la Seconde Guerre mondiale éclate. Abel Tiffauges s’enrôle et se passionne alors pour les pigeons voyageurs. Rapidement fait prisonnier par les Allemands, il n’est pourtant jamais entravé dans ses mouvements et acquiert une position de choix dans un centre d’éducation pour les jeunesses hitlériennes. Là, il assouvit enfin la passion dévorante qu’il entretient à l’égard des jeunes garçons.
Abel Tiffauges est fasciné par les jeunes corps des garçons et il en entreprend une lecture systématique et révérencieuse. Tiffauges déchiffre les corps, leurs lignes, leurs pleins et leurs déliés, et il excelle à les catégoriser, dans une volonté maniaque de thésaurus. Abel Tiffauges est un ogre qui ne goûte jamais à la chair, mais qui tente de dérober les essences mêmes de ses proies. « Je compris que j’obéirais d’autant mieux à mes aspirations alimentaires que j’approcherais davantage l’idéal de la crudité absolue. » (p. 94) En collectionneur avide, il cherche toujours plus loin la pièce qui manque à son butin.
Dans son journal qu’il a intitulé Écrits sinistres, il célèbre aussi le mystère divin de l’acte de porter. Il appelle cette mission, sainte à ses yeux, la phorie et il l’entoure de respect et de religiosité. « Je saisis pour la première fois le sens tiffaugéen du sacrement du baptême : un petit mariage phorique entre un adulte et un enfant. » (p. 148) À l’instar de son travail sur les corps des jeunes garçons, il accumule obstinément les symboles sacrés ou païens qui célèbrent la phorie.
Il y aurait tant à dire sur ce superbe roman de Michel Tournier. L’auteur m’avait déjà éblouie avec Vendredi ou les limbes du Pacifique où il réécrivait le mythe de Robinson. Ici, il reprend un célèbre poème de Goethe : le Roi des Aulnes est un charmeur dévoreur d’enfants, terrible figure d’ogre s’il en est. Le talent de Michel Tournier à extrapoler les mythes littéraires est sans égal à mes yeux. Dans Le Roi des Aulnes, il mêle le mythe aux références bibliques et mythologiques et fait regorger son texte d’analogies, de symboles et de métaphores. L’intertextualité mise en œuvre semble inépuisable et l’auteur fait montre d’une érudition qui n’a rien de vantarde, qui n’est qu’hommage aux classiques et volonté de les surpasser pour mieux les honorer.
Je m’attarde un instant sur le nom du protagoniste. Dans la Bible, Abel est le nomade assassiné par son frère Caïn : dans Le Roi des Aulnes, Abel Tiffauges est sans cesse en mouvement et il progresse vers l’est, vers la lumière. Il échappe toujours à la mort et son initiation est continue auprès de différents maîtres. Le frère assassiné est ici bien vivant et décidé à prendre revanche sur la vie. Quant au patronyme, Tiffauges, c’est le nom du château de Gilles de Rais, compagnon de Jeanne d’Arc et assassin d’enfants. Son histoire a été reprise dans de nombreuses légendes présentant des ogres, dont le cruel Barbe-Bleue. Abel Tiffauges est donc un ogre en marche : courez, enfants ! Il vient pour vous !
La violente beauté du style de Michel Tournier m’émeut au-delà du dicible. Je suis sans voix devant les inventions lexicales de l’auteur : soucieux d’utiliser exactement le mot qui convient pour désigner la chose pensée, observée ou ressentie, il ne se contente pas de synonymes ou de périphrases, il crée des termes à la mesure des idées qu’il développe. L’épaisseur sémantique ainsi créée fait du texte un recueil unique de termes, un dictionnaire à lui seul. Michel Tournier crée le sublime à partir du prosaïque, voire du tabou. La sensualité de son texte est vicieuse, dépravée et souvent défécatoire, mais elle est sensualité pleine et entière.
J’arrête ici ce trop long billet en vous recommandant ce roman. Ne soyez pas rebuté par l’érudition du texte. Plongez les yeux fermés dans la spiritualité animale d’Abel Tiffauges !