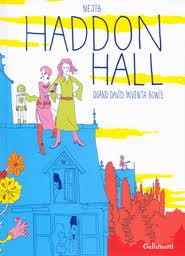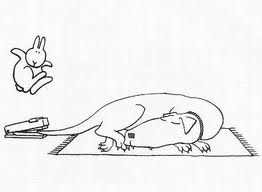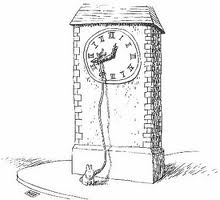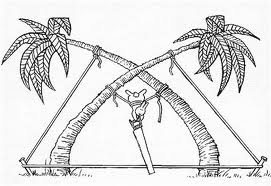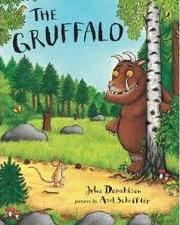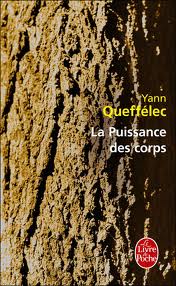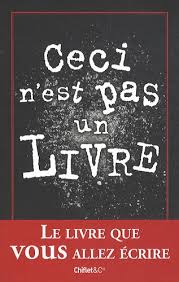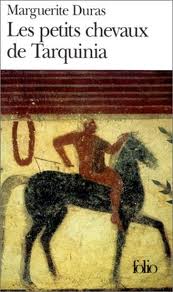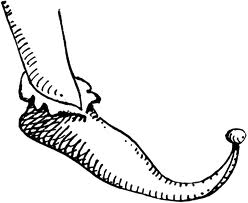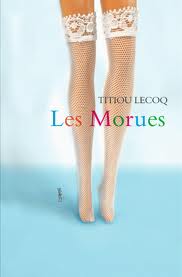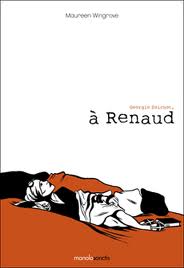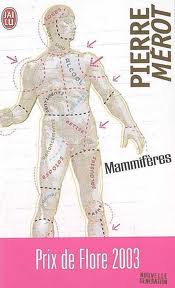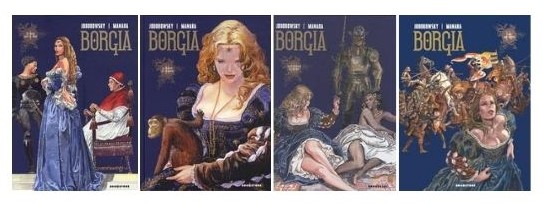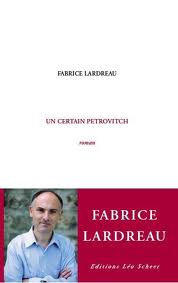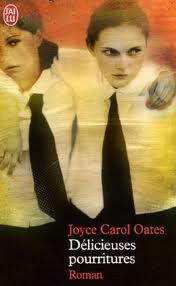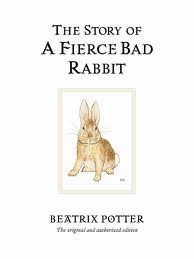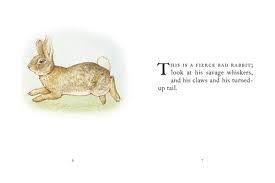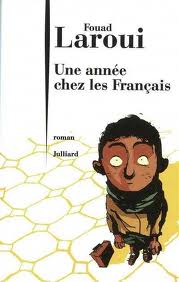Roman graphique : scénario de Boulet ; dessins et couleurs de Pénélope Bagieu.
La première planche est une pleine page : une jeune fille est seule sur un banc au milieu de la ville sur laquelle se couche le soleil. Dans ces couleurs rose orange, on sent bien que quelque chose cloche. Cette jeune fille a oublié qui elle est, d’où elle vient et quelle est sa vie. Farfouillant dans un sac qui ne peut être que le sien, elle trouve son prénom, Éloïse, et son adresse. Il y aussi un sac plein d’affaires dans la poubelle. Dans son appartement, elle ne reconnaît rien. « Il faut que je me fasse une raison : RIEN ne me revient. Est-ce que je demande de l’aide ? À une famille que je ne connais plus ? » (p. 70) Éloïse fouille les placards et les boîtes sous l’œil ronronnant d’un animal qui doit être son chat. Mais rien, décidément rien, ne lui évoque le moindre souvenir. L’ancienne Éloïse est perdue dans un avant hermétique et résolument opaque. « J’ai disparu de mon vivant. » (p. 195) pense-t-elle et il semble qu’elle ait vu juste.

Mais si sa mémoire s’est arrêtée, la vie continue. Éloïse reprend son travail en librairie et se rapproche d’une collègue, Sonia. La jeune fille n’a de cesse de vouloir remonter le fil de son existence. Elle imagine des complots avec les services secrets, des amours contrariées, des expériences extraterrestres, etc. Tout et n’importe quoi serait le bienvenu pour expliquer cette amnésie si étonnante. Dans son appartement meuble façon catalogue suédois, parmi « des trucs que tout le monde lit ou a lus » (p. 115), Éloïse aimerait redevenir quelqu’un, mais elle ne se sent pas à sa place. « C’est quand même TELLEMENT bizarre… Pas un souvenir… Comme si j’avais pris la place d’une autre… mais qui aurait mon visage… » (p. 139) Mais finalement, cette amnésie, n’est-ce pas une chance extraordinaire ?

Ce bel album interroge la mémoire, bien entendu, mais surtout l’identité. À quel point pouvons-nous affirmer qu’une identité est la nôtre ? N’est-elle pas façonnée de tout ce dont nous abreuve la société ? À en juger par les demandes des clients de la librairie où travaille l’héroïne, je suis tentée de répondre par l’affirmative. Plutôt qu’avoir une identité (ou du style), je préfère être quelqu’un. J’ai trouvé très drôle et très touchant la façon dont Éloïse traque ses souvenirs. Il me semble que je ferai exactement la même chose : dresser des listes, être méthodique, faire des recoupements et, surtout, ne rien dire à personne, attendre avant d’exposer ma bizarrerie.

C’est avec plaisir que j’ai retrouvé le pinceau de l’illustratrice. Il me semble que son dessin s’affine, s’affirme et s’épanouit vraiment dans cet album, davantage que dans Cadavre exquis. Ma main au feu que Pénélope Bagieu s’est représentée sous les traits d’une cliente un peu survoltée. La collaboration avec l’excellent Boulet est en tout cas une réussite ! Ce roman graphique est attachant et intelligent, loin des grosses ficelles des histoires d’amnésie. Bref, encore un album que je vous recommande. (Non, ne me haïssez pas, c’est de bon cœur.)