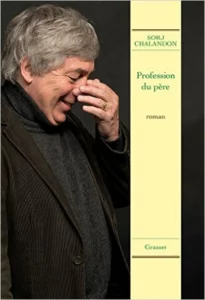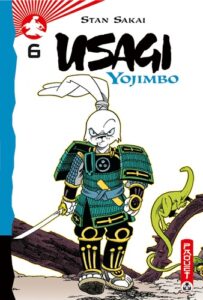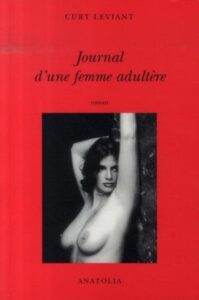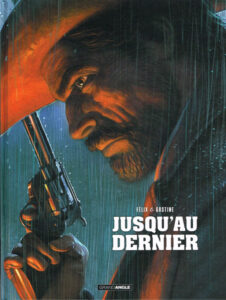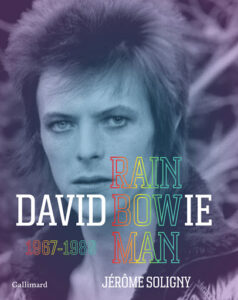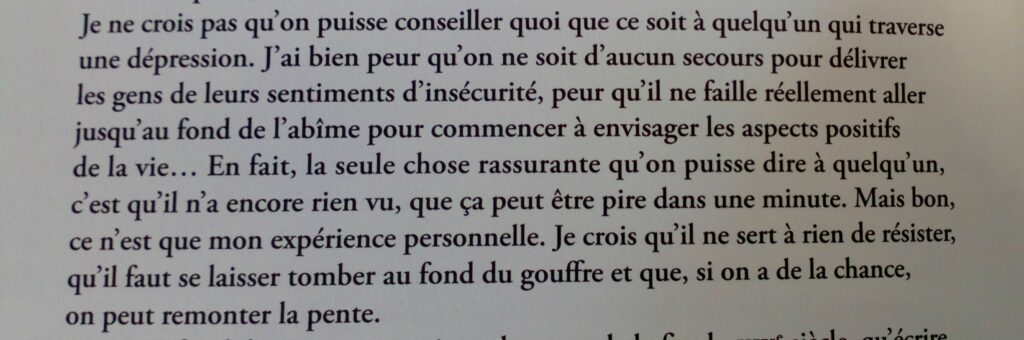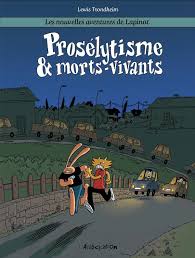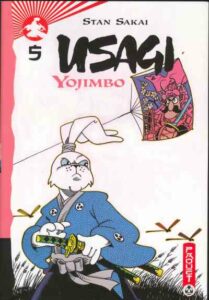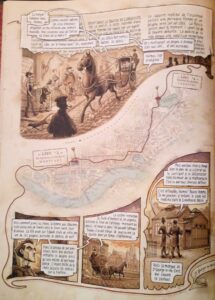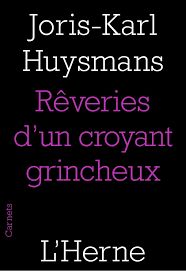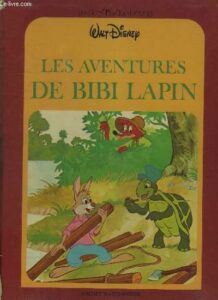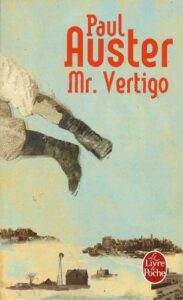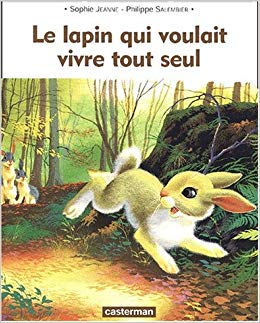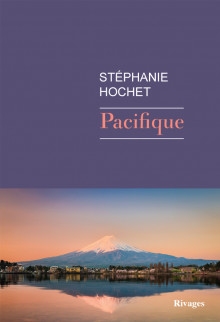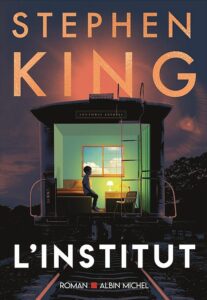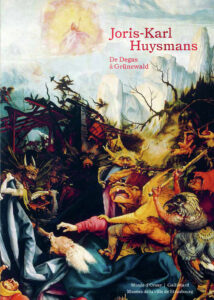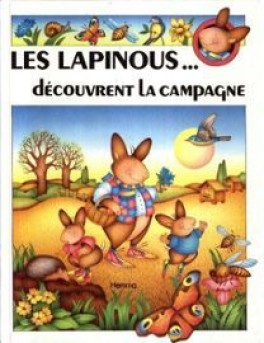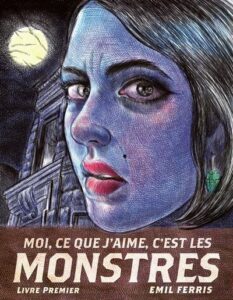Avec un répertoire où le lecteur trouvera, dans l’ordre alphabétique, divers détails croustillants et bien d’autres surprises.
Roman de Curt Leviant.
Lors d’une réunion d’anciens élèves, Charlie Perlmutter retrouve son camarade Guido Veneziano-Tedesco. Le premier est psychologue et il accepte d’écouter le second, aux prises avec une épineuse relation extraconjugale. « Si tu avais à raconter la même histoire que moi, tu ne la raconterais pas du tout. Et si tu la racontais, tu commencerais lentement. Avec circonspection. » (p. 38) Guido est marié. Son amante, Aviva, l’est aussi. Leur relation est passionnée et puissamment physique. À force d’entendre son ami en parler avec autant de fougue, Charlie décide de rencontrer Aviva pour se forger sa propre opinion. « Une femme aussi divine pouvait-elle vraiment exister ? » (p. 155)
De parties en chapitres, le narrateur et le point de vue changent, ce qui donne une superposition imparfaite des récits, tout comme l’est la superposition des corps adultères. « Tu vois ? C’est ça le côté affreux de notre liaison. Les rapports normaux n’existent pas. » (p. 262) Désir, plaisir, apprentissage des choses sexuelles et des mystères amoureux, grandes joies et amertumes, tout cela se percute et s’entrechoque dans ce roman immense. Les personnages ne sont pas taillés d’un bloc, mais ils sont intenses. Guido est un cruel amant, possessif et incapable d’aimer. Aviva est une affamée d’amour, frustrée et triste. « Ta vie est pleinement épanouie, et moi, je ne suis qu’une petite aventure à la sauvette. » (p. 249) Charlie est aussi compréhensif que curieux. « Il était à tel point subjugué par sa conquête qu’il voulait la partager – avec moi. » (p. 155) Seul le mari d’Aviva, l’Arabe, semble un peu caricatural, mais cela renforce d’autant plus la délicatesse de la belle violoncelliste. Finalement, tout le roman noue des histoires de vengeance qui aboutiront à l’extrême fin du texte, dans un grand éclat grinçant et tragique.
Journal d’une femme adultère est un roman à clé avec des ♥ dans les pages qui renvoient au répertoire final. « Prenez la peine de suivre jusqu’au bout les suggestions proposées dans l’Index et le Répertoire alphabétique, car vous pourrez ainsi savourer les friandises, bons mots et autres surprises susceptibles de rehausser, de clarifier, de modifier, voire parfois de contredire le corps du texte. » (p. 11) Avec cette invitation liminaire, l’auteur se montre facétieux, tout en laissant le lecteur maître de son expérience de lecture. Car ce dernier a aussi le droit de ne pas se référer aux notes finales et de les consulter uniquement en achevant le roman. Et pour vous dire jusqu’à quel point l’auteur est facétieux, c’est qu’il cite ses autres romans dans celui-là, comme ayant été écrit par un brillant écrivain !
J’ai découvert ce roman en 2008 au Canada, pendant ce qui reste la période la plus heureuse de mon existence. Confinement oblige, je cherche tout ce qui peut m’apporter un peu de bien-être. J’ai pensé que relire ce texte serait à même de me faire replonger dans la belle atmosphère d’alors. Et bien m’en a pris, car ça a fonctionné ! J’ai retrouvé l’humour si fin qui m’avait enchantée lors de ma première lecture. « Moi, je suis athée. / Je me convertirai […] Avec l’aide de Dieu, moi aussi je deviendrai athée. » (p. 265) J’ai aussi replongé dans cette exquise ambiance érotique qui émane de toutes les pages. Voilà un texte à lire à deux, au creux d’une couette…
Et maintenant, plus que jamais, après L’énigme du fils de Kafka, je veux lire tous les autres romans de l’auteur, du moins ceux traduits en français.