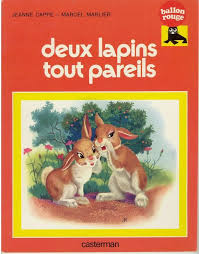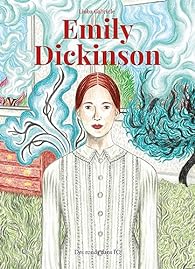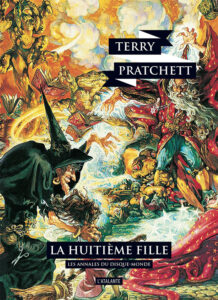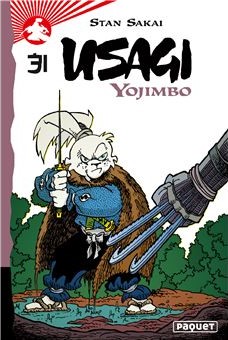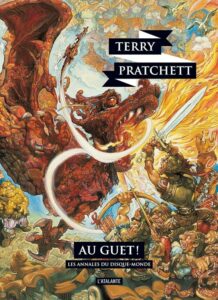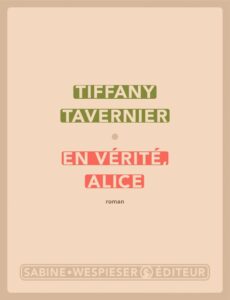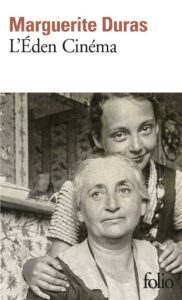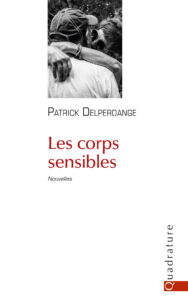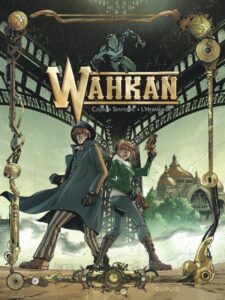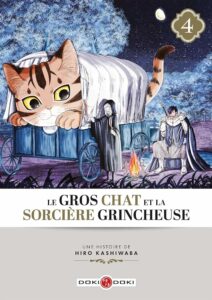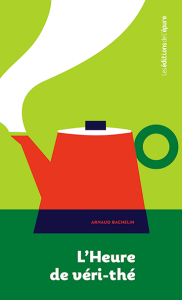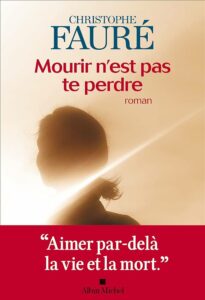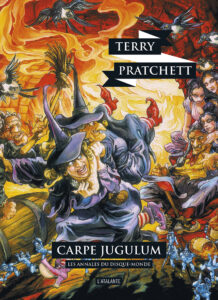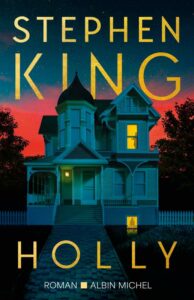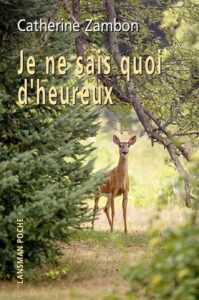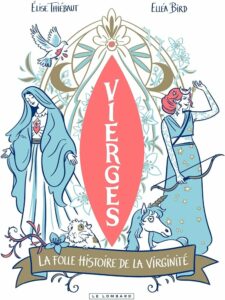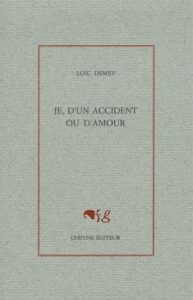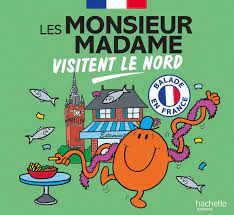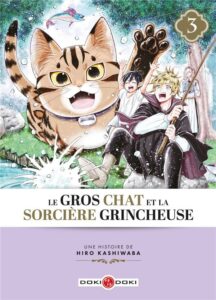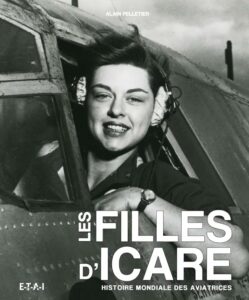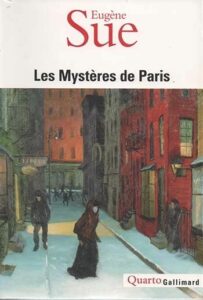Essai d’Anaïs Lecoq.
La bière, voilà bien une boisson de bonhomme ! C’est l’incontournable des soirées pizza-foot, évidemment (toujours) entre potes. C’est la petite mousse bien méritée par Monsieur après 30 minutes à tondre la pelouse, bien assis sur son motoculteur qui consomme plus que la dodoche de Mémé. Ouais, la bière, c’est pas pour les gonzesses, à croire qu’on la produit en fermentant de la testostérone… « Cette boisson reste encore aujourd’hui profondément associée au masculin dans l’imaginaire collectif. » (p. 11) Je force le trait, vous trouvez ? Si peu…
Dans le monde brassicole, comme dans tous les autres mondes, les noms de femmes ont bien du mal à se faire entendre et à être retenus, inévitablement remplacés et écrasés par ceux des hommes. Inévitablement, vraiment ? Pas pour Anaïs Lecoq qui, en retraçant l’histoire de la bière, rappelle que les femmes ont très longtemps présidé à sa production. OK, elles ont été écartées de cette activité dès que les hommes ont compris qu’il y avait de l’argent – beaucoup d’argent – à se faire. Mandieu, laisser les bonnes femmes réussir économiquement et devenir financièrement indépendante, ça va pas la tête ? « Alors que c’est la division genrée du travail qui conduit à l’origine les femmes à produire de la bière, c’est ce même principe qui les écarte ensuite de la pratique. Marrant comme les curseurs peuvent facilement être déplacés pour coller aux désirs des hommes. Tantôt afin de faire trimer bobonne pour nourrir la famille avec de la bonne ale, tantôt pour reprendre le business et s’accaparer le pactole et la gloire. » (p. 35)
Mais les femmes ont-elles alors disparu ? Pas du tout, vous voyez le mal partout : elles sont immanquables sur les étiquettes et les publicités, joliment sanglées dans des atours légers pour vous proposer une bonne pinte rafraichissante. « Si on les a exclues du brassage, on a quand même gardé les femmes sous le coude pour aguicher ces messiers et les pousser à consommer toujours plus. » (p. 12) Passer de bobonne à bimbo, en voilà une promotion… L’industrie brassicole, comme toutes les autres, objective le corps de la femme dans des publicités sexistes et fétichisantes qui imprègnent l’imaginaire collectif et la représentation que les femmes ont d’elles-mêmes. Mauvais goût, vous dites ? Oui, et je ne parle pas des bières premier prix. Attendez que je (Anaïs Lecoq) vous parle de la grossophobie et du racisme décomplexé dans le branding et la communication de certaines marques de bière, vous allez tousser fort !
Mais alléluia, la lumière apparaît au fond de la bouteille ! Avec le féminisme-washing, nous gonzesses avons droit à des bières brassées juste pour nous : sucrées, fruitées, mignonnes, pas trop fortes… Et qui produit ces boissons qui n’ont de bière que le nom ? Mais si, vous avez la réponse ! « On n’est pas bien là, entre mecs, à réinventer le féminisme ? » (p. 67) Ça me rappelle une anecdote personnelle. Pendant une soirée d’été en terrasse avec des amis (tous des hommes), je commande une Guinness (mon péché mignon depuis longtemps). Le serveur revient avec un Ricqlès. Je le corrige et il me répond : « J’avais bien compris, mais je me suis dit que vous confondiez les deux boissons. C’est fort, la Guinness, vous savez. » J’étais alors une petite chose de 22 ans et quelques et j’ai bafouillé que c’était très bien, que j’aimais aussi beaucoup le Ricqlès. Ce mec habillé en pingouin m’a écrasée de sa certitude qu’une femme (jeune de surcroît), ça n’aime que les boissons sucrées. Maintenant, j’ai un peu plus de bouteille et je commande fermement : « Une Guinness, s’il vous plaît. En pinte, évidemment ! »
Pour en revenir au livre d’Anaïs Lecoq, plusieurs études ont prouvé que les hommes n’aiment pas consommer des produits présentés comme féminins. Le savon à la lavande ou la bière à la cerise, pouacre, c’est pas bon pour leurs gros biscoteaux ! Donnez-leur plutôt un gel douche à l’essence de pneu et une bière qui titre fort ! Pauvres petites choses, effrayées par un packaging qui tire un peu trop sur le pastel… « Nos goûts ne sont pas innés, ils sont conditionnés. Cette corrélation entre les saveurs fruitées et la féminité est omniprésente dans la bière. » (p. 86) C’est aussi pour ça que, quand je déguste ma Guinness (et je voudrais, si vous le permettez, déguster en paix), j’entends parfois que je bois comme un homme. C’est-à-dire ? Par la bouche ? Oui, c’est comme ça que l’humanité boit depuis toujours. Le goût, Sandrine Goeyvaerts en parle brillamment dans Cher Pinard, publié aux mêmes éditions Nouriturfu. Lisez aussi son Manifeste pour un vin inclusif.
Parlons d’un sujet avec moins de légèreté, l’alcoolisme. Cette maladie ne doit pas prêter à sourire ni être l’occasion d’un bon mot. Quand on l’étudie par le prisme du féminisme (non, ça, ce n’est pas une maladie), on comprend que les femmes alcooliques souffrent d’une double peine : la pathologie en question et le poids d’une société organisée pour les opprimer depuis des siècles. « Aux origines de l’alcoolisme des femmes, c’est bien le patriarcat qu’on retrouve pour nombre d’entre elles. Avec, pour principal outil, la charge mentale. » (p. 101) Sur le sujet de l’alcoolisme au féminin, je vous renvoie au très puissant témoignage de Charlotte Peyronnet, Et toi, pourquoi tu bois ?
Bon, alors, c’est foutu, les femmes ont perdu la bataille de la bière ? Non, nous consommateur·ices, nous avons le choix de refuser les produits aux affichages sexistes/oppressifs et de nous tourner vers des offres inclusives et décentes. « Les femmes ne sont pas votre caution diversité, je vous rappelle que nous représentons la moitié de l’espèce humaine. » (p. 131) Des brasseries gérées par des femmes, il y en a. Alors oui, il faut les chercher et ça demande un peu d’effort parce qu’elles n’ont pas vraiment table ouverte dans les raouts brassicoles où ça se congratule entre couilles parce qu’une conférence parle de la place de la femme dans l’industrie houblonnée. « Il paraît bien compliqué d’avoir une quelconque influence sur les politiques brassicoles quand on est complètement absentes des institutions et syndicats représentatifs. » (p. 108) Mais en fait, c’est comme tout, si on cherche, on trouve. Et une fois qu’on a trouvé, on trouve encore plus ! Valoriser et consommer les productions portées par des femmes, ça ne rend pas lesbienne (et je ne vois pas en quoi ça serait un mal, ça, mais c’est un autre sujet) et ça ne fait pas flétrir les valseuses, promis ! Anaïs Lecoq nous donne des pistes pour que le monde de la bière change, du/de la brasseur·se au/à la buveur·se. Le point médian, ça en défrise certains ? (Oui, là, je me contente du masculin) Dommage pour vous, parce que je ne vais pas arrêter… « Voilà des décennies qu’on parle de ‘féminiser’ la langue française pour mieux coller aux évolutions sociétales non sans avoir affaire à un régiment de Jean-Michel Linguistes s’offusquant de l’acharnement des féministes à massacrer leur langue. Cette dernière a au contraire été masculinisée au fil des siècles, par des mecs trop fragiles pour accepter qu’une femme puisse oser être une autrice ou une doctoresse. Ce forcing organisé et institutionnalisé a réussi à évincer progressivement les femmes de la langue et surtout des postes qui ne devaient pas ou plus leur revenir. » (p. 27) Ah ça, je réponds HELL YEAH MES SŒURS !
Anaïs Lecoq mène une démonstration impitoyable et brillante. Les données sont sourcées et solides et elles gagnent en force grâce au délicieux humour misandre de l’autrice. J’ai essayé de lui rendre hommage avec ce billet un peu féroce. Lisez le livre d’Anaïs Lecoq et buvez des bières, Mesdames, avec modération évidemment ! Ce livre ne peut que rejoindre de nombreux autres sur mon étagère de lectures féministes !