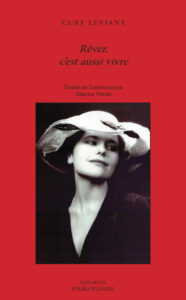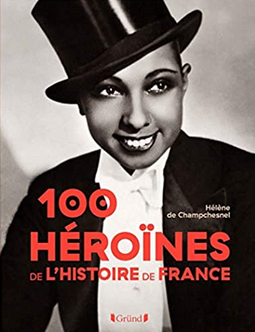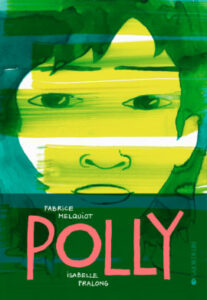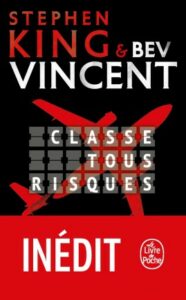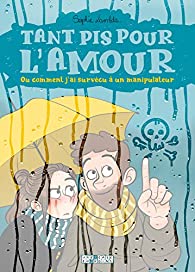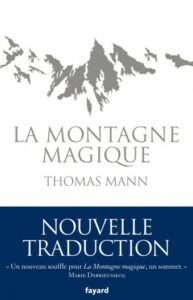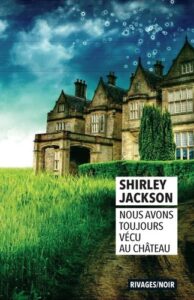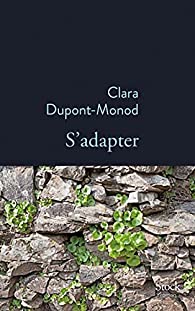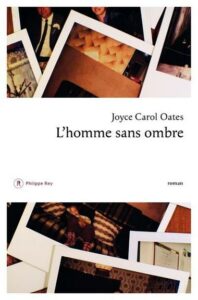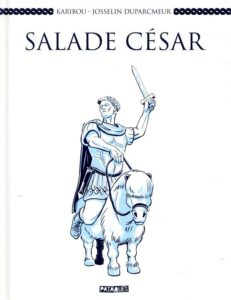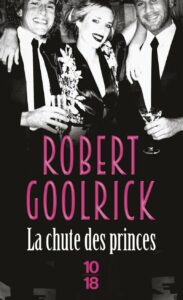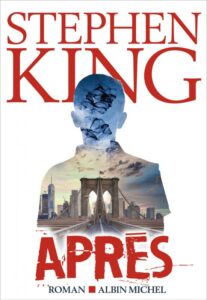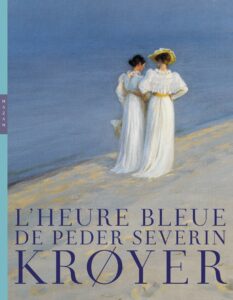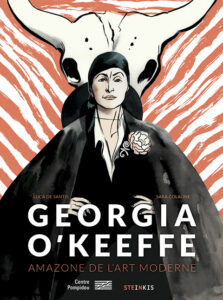Samuel est professeur d’université, écrivain raté et joueur compulsif sur une plateforme en ligne. Son éditeur menace de le poursuivre pour non remise de manuscrit, mais Samuel lui propose une nouvelle idée : un livre à charge contre sa propre mère. Faye Andresen-Anderson a en effet agressé le gouverneur républicain Sheldon Packer, passant en un jet de cailloux d’une parfaite inconnue à une pasionaria pacifiste, ou à une terroriste au passé trouble, selon les points de vue. Plus que tout autre, Samuel a des reproches à adresser à cette mère qui l’a abandonné quand il était enfant. « Un assassinat de papier, intimité, vie publique, tout y passe. […] En fait, c’est comme si deux longues décennies de ressentiment et de douleur avaient enfin trouvé, pour la première fois, un exutoire. » (p. 83) Mais à mesure que Samuel creuse dans le passé de Faye pour comprendre qui est cette femme arrêtée pour prostitution et émeute en 1968 à Chicago, il découvre une personne complexe et fragile, victime impuissante d’injustices et de malentendus. « Il y a des choses que peut-être tu préférerais ne pas savoir. Les enfants ne sont pas obligés de tout savoir sur leurs parents. » (p. 251)
La construction de ce premier roman est magistrale. Les parties alternent entre l’été 1968 avec la jeunesse de Faye et son entrée à l’université, l’été 2011 durant lequel se déroule l’intrigue principale et l’année 1988 qui a vu l’abandon de Samuel par sa mère. En parallèle de l’histoire centrale se tendent deux intrigues qui se relâcheront au moment idoine : le désaccord profond entre Samuel et Laura, une étudiante menteuse et tricheuse, et l’amitié étrange entre Samuel et Pwnage, joueur en ligne complètement accro. La mécanique mise en place par l’auteur est digne du drame antique : tout concourt au final, sans que les personnages aient une chance d’échapper à l’enchaînement des événements. Les fils de la trame se rejoignent de manière un peu forcée à mon goût à la fin du roman, mais cela donne au texte l’ampleur des romans rocambolesques du 19e siècle. Et il ne faut pas oublier l’humour féroce que l’auteur distille dans ses pages : sa critique du capitalisme en la personne de l’éditeur de Samuel est savoureuse !
Le vieux pays est la Norvège d’où est originaire le père de Faye. Cet homme mutique au regard souvent perdu dans le lointain a pris avec lui des mythes et des histoires qu’il a presque rendus réels pour sa fille. Et il faut des décennies à celle-ci pour se libérer des fantômes qui pèsent sur son existence, tout comme il faut longtemps à Samuel pour comprendre les décisions de sa mère. « Si le temps guérit tant de choses, c’est qu’il nous dévie en des lieux où le passé semble impossible. » (p. 232) Ce roman parle du pardon que l’on peut accorder aux siens, mais aussi de résilience. La vie n’étant pas une histoire dont vous êtes le héros, il est impossible de revenir en arrière pour changer ses choix. En revanche, il appartient à chacun de tirer le meilleur de chaque situation. « Tu n’es pas le héros de cette histoire, c’est l’histoire qui décide pour toi. […] Tu n’as jamais décidé que ta vie ressemblerait à cela – elle est juste devenue ainsi. Ce qui t’est arrivé t’a forgé. Tout comme le canyon ne choisit pas comment la rivière le sculpte. Il laisse l’eau dessiner ses contours. » (p. 365)
Cet énorme premier roman (700 pages !) de Nathan Hill est une plongée fabuleuse dans l’histoire des États-Unis, entre immigration et émeutes, industrialisation meurtrière et guerre sanglante, rêve américain et déception. Une grande lecture !!!