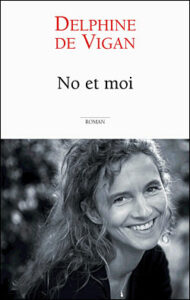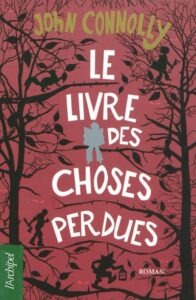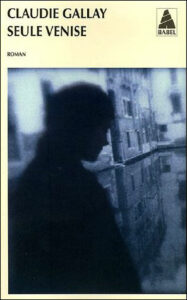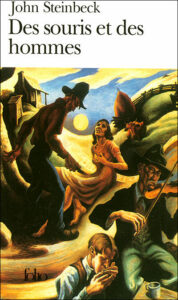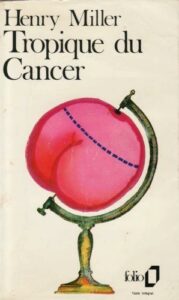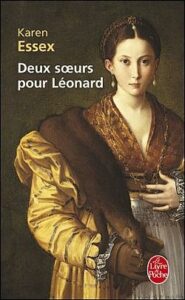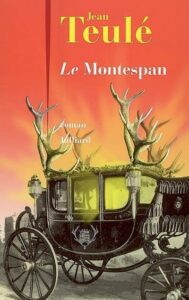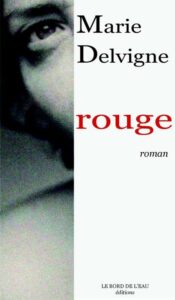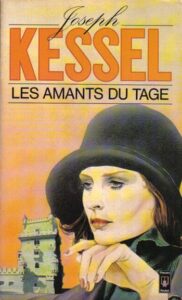Roman de Salman Rushdie.
Moares Gama-Zogoiby est le narrateur d’une surprenante histoire: la sienne et celle de sa famille. Son récit commence bien avant sa naissance. Il se réclame, ainsi que son ascendance, de l’illustre Vasco de Gama. Dans une famille où l’excès et la différence sont monnaie courante, il trouve sa juste place. Biographe familial cynique, tendre, ingrat, révolté ou désabusé, il dresse aussi un portrait vitriolé de l’Inde, avant et après la domination anglaise, dans laquelle des personnages comme Gandhi ou Nehru ont des rôles bien moins grands que ceux qu’ils jouent dans la famille Gama-Zogoiby.
Malchanceux, le Maure l’est dès sa naissance. Fils d’Aurora, une héritière et artiste de génie mais femme de peu de cœur et d’Abraham, juif de Cochin, escroc et soumis à son épouse, Moares, dit le Maure, se distingue à plus d’un titre. Né très largement avant terme, affublé d’une main difforme, il est soumis à un vieillissement deux fois supérieur à la norme. Malchanceux par son nom, malchanceux par son ascendance, il fait aussi des choix malheureux. Il semblerait qu’il s’entête à suivre la voie barrée pour mieux se fourrer dans des situations impossibles. Il échappe de peu au contrat malhonnête que son père passe avec sa grand-mère, mais c’est pour mieux devenir la créature de sa mère, à la fois adorée et détestée, réclamée et repoussée.
Aurora de Gama est belle, impertinente, gourmande et dynamique. Fille adorée d’un père faible et brisé par la mort de sa femme, elle a grandi sans autorité et a gardé de son enfance une insouciance, une liberté et une volonté à toute épreuve. Elle attire les regards et les convoitises des hommes et des femmes. Entourée d’artistes, dont le peintre Vasco de Miranda qu’elle rendra désespérément fou d’amour, elle gravite au centre d’un univers où tout lui est consacré. Son fils n’est qu’un joyau de plus dans son coffre aux trésors.
Dernier-né d’une fratrie de filles, Moares grandit entouré de trois sœurs dont les prénoms tronqués ou déformés tendent à se confondre pour créer une seule entité sororale, polymorphe et inquiétante. Ina, Minnie et Mynah connaissent des destins sublimes et décadents. Toutes les femmes que fréquentent le Maure portent en elles un germe d’auto-destruction. Entre Dilly Hormuz, sa préceptrice et première amante, et sa fiancée perdue, la superbe et courageuse Nadia Wadia, le Maure connaît l’éblouissement des sens et du cœur auprès d’Uma Sarasvati. La jeune femme, sculpteur au talent naissant, est passionnément attirée et obsédée par Aurora, la pétulante et charismatique maman du Maure. Entre les deux femmes commence malgré tout un combat dont l’enjeu est Moares.
Moares est aussi un boxeur surprenant même s’il utilise sur le tard son talent destructeur. Pendant des années, il travaille dans l’entreprise paternelle, prétendument consacrée à la vente de talc pour bébés, même s’il est de notoriété publique qu’Abraham Zogoiby est un magnat de la drogue indienne.
Que cette lecture a été ardue ! Voilà un livre qui ne se laisse pas faire ! Les cent premières pages, loin d’être déplaisantes, riches d’un humour caustique et de détails savoureux, m’ont cependant paru interminables. Il est absolument insupportable d’attendre aussi longtemps pour arriver au cœur du sujet. Avant d’en venir au personnage principal, il faut d’abord faire connaissance – et en profondeur ! – avec deux générations d’aïeux dont les aventures picaresques nous entraînent bien loin du sujet principal. A moins que le sujet principal ne soit qu’un prétexte pour dessiner une saga familiale qui ne se comprend que dans l’ampleur et la démesure.
Le motif récurrent du dernier soupir du Maure, traité par le texte et par l’image, est intelligemment disséminé au fil des pages. Cela donne envie de relire Chateaubriand. Aurora est un personnage fabuleux, mais il aurait été encore plus fabuleux qu’elle ait existé et qu’elle ait peint les toiles dont les descriptions accompagnent chaque épisode de l’histoire de Moares. Les représentations qu’elle fait d’elle et de son fils sont allégoriques, psychédéliques, iconoclastes, blasphématoires. Cela aurait un délice de les avoir sous les yeux.
Je suis toujours très sensible à la synesthésie d’un texte. J’avais beaucoup apprécié la lecture du Parfum de Patrice Süskind, pour le talent dont l’auteur a fait preuve pour convertir les mots en odeurs. Dans le texte de Salman Rushdie, j’ai retrouvé le même talent. De la première étreinte enivrante entre Aurora et Abraham sur des sacs de poivre, de cardamome et de cumin aux promenades dans les dédales de Bombay, on respire l’Inde onirique de l’explorateur Vasco de Gama, pays merveilleux d’épices et de tissus éblouissants. « De grands arbres généalogiques issus de petites graines: il convient, n’est-ce-pas, que mon histoire personnelle, l’histoire de la création de Moares Zogoiby, ait son origine dans le retard d’un chargement de poivre? » (p.85) Une petite graine de poivre comme un grain de sable qui change le fonctionnement classique de la machine.
Superbe hommage à l’Inde, portrait à l’acide également. L’auteur n’épargne pas son pays d’origine. « L’Inde Mère avec son faste criard et son mouvement inépuisable, l’Inde Mère qui aimait, trahissait, mangeait et dévorait ses enfants puis qui les aimait de nouveau, ses enfants dont les relations passionnées et les querelles sans fin allaient bien au-delà de la mort; elles s’étendaient dans les immenses montagnes comme des exclamations de l’âme, et le long des larges fleuves charriant miséricorde et maladie, et sur les plateaux arides ravagés par la sécheresse sur lesquels des hommes entamaient la terre stérile à la pioche; l’Inde Mère avec ses océans, ses palmiers, ses rizières, ses buffles aux trous d’eau, ses grues aux cous comme des portemanteaux perchées sur la cime des arbres, et des cerfs-volants tournant hauts dans le ciel, et les mainates imitateurs, la brutalité des corbeaux au bec jaune, une Inde Mère protéenne qui pouvait devenir monstrueuse, qui pouvait n’être qu’un ver sortant de la mer […], qui pouvait devenir meurtrière, qui dansait avec la langue de Kali et le regard qui louche pendant que mourraient les multitudes; mais au-dessus de tout, au centre exact du plafond, au point où convergeaient les lignes de toutes les cornes d’abondance, l’Inde Mère avec le visage de Belle. » (p. 77)
L’Orient et l’Inde, ce ne sont pas des zones géographiques vers lesquelles mes pas se porteraient naturellement, encore moins ma curiosité. Je n’y connais pas grand chose, que ce soit en terme de culture, de religion, de spiritualité, d’histoire, et que ne sais-je pas encore ! Je pense sans aucun doute que de grandes choses m’ont échappées pendant la lecture, des finesses culturelles, des anecdotes, des traits d’humour, des vitupérations politiques et historiques… Devant une telle œuvre, on se sent humble. Moi, je me suis sentie toute petite. Le texte foisonne, se développe, bondit et repart en arrière, entre analepses fulgurantes et digressions labyrinthiques. Il y a un peu du récit de Shéhérazade, un peu des Mille et une nuits dans ce texte qui semble ne pas vouloir finir. Et les cent dernières pages, bijou du livre, révèlent les conditions de narration de cette saga rocambolesque et justifient les extrapolations et récits parasites dont on se demandait ce qu’ils apportaient vraiment au texte. Également récit policier, comme on le comprend dans les dernières parties du livre, l’intrigue s’amuse à nier ce qu’elle défendait pour mieux proposer de nouvelles solutions.
Entre le conte d’Andersen La reine des neiges et Le marchand de Venise de Shakespeare, le texte se nourrit et régurgite tout un palimpseste littéraire et baroque. Les érudits parlent de réalisme magique pour qualifier l’écriture de Salman Rushdie. Pour faire simple, c’est quand le fantastique du conte ou de la légende se mêle au réel pour donner une nouvelle réalité dans laquelle on retrouve des éléments concrets mais qui offre aussi des anomalies parfaitement acceptées. Un des derniers exemples de textes de ce genre qui m’a renversé est Cent ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Ensuite, il y a eu Le livre des nuits de Sylvie Germain. Le dernier soupir du Maure est tout aussi renversant, avec sa famille folle et tentaculaire, et ses péripéties démentielles !